« Santé mentale : 5 choses à retenir de la dernière étude sur la dépression en Europe »
Date de publication : 9 janvier 2025

Juliette Vienot de Vaublanc, Inès Simondi et Élisa Brinai constatent dans La Croix que « la France est l’un des pays les plus dépressifs en Europe, selon une étude publiée […] par la direction statistique des ministères sociaux (Drees) sur la prévalence de cette maladie dans les pays de l’Union européenne ».
Les journalistes expliquent que « l’analyse s’appuie sur les chiffres de la dernière enquête santé européenne (EHIS), pour laquelle plus de 300.000 personnes ont été interrogées en 2019 au sein de l’Union européenne et dans quelques pays limitrophes ».
Elles évoquent ainsi « de fortes disparités entre le Nord et le Sud » : « En 2019, environ 6% des Européens souffraient de dépression. Mais […] ce taux varie considérablement en fonction du pays. Les risques de développer des symptômes dépressifs sont ainsi bien plus élevés dans le nord et l’ouest de l’UE, en particulier en France, en Suède et en Allemagne. Les habitants du sud et de l’est du continent s’avèrent, eux, moins touchés. En Grèce, en Serbie comme à Chypre, moins de 3% de la population déclare des symptômes dépressifs ».
Juliette Vienot de Vaublanc, Inès Simondi et Élisa Brinai notent en outre que la France est « mauvaise élève » : « Le pays affiche l’un des taux de dépression les plus élevés d’Europe, avec 11% de la population de plus de 15 ans affirmant souffrir de cette pathologie, presque deux fois plus que la moyenne européenne de 6% ».
Les journalistes précisent que « toutes les tranches d’âge ne sont pas touchées de la même manière. Les seniors sont les plus concernés, avec 16% d’entre eux souffrant de dépression, contre une moyenne de 12% en Europe. Parmi les jeunes, environ 10% sont affectés, un taux comparable à celui des pays d’Europe du Nord et de l’Allemagne (9%) ».
Elles expliquent que « l’effet de l’âge dépend de la région » : « Si, pour certains, être à la retraite améliore la santé mentale, pour d’autres c’est un facteur de dépression. Dans le sud et l’est de l’Europe, les jeunes sont relativement épargnés, mais les cas de dépression augmentent avec l’âge, avec un pic après 70 ans. […] En revanche, dans les pays d’Europe du Nord la tendance s’inverse : les jeunes souffrent davantage de dépression, puis la prévalence «diminue au fur et à mesure que l’âge augmente, jusqu’à 70 ans» ».
Juliette Vienot de Vaublanc, Inès Simondi et Élisa Brinai retiennent par ailleurs « un lien fort entre santé mentale et santé physique » : « Le rapport s’intéresse en particulier aux jeunes (15-24 ans) et aux personnes de plus de 70 ans. Pour ces deux catégories, le risque de souffrir de symptômes dépressifs augmente pour les personnes en mauvaise santé ».
Les journalistes relèvent enfin que « l’isolement social [est] un facteur de dépression important ». Elles soulignent que « l’entourage affectif est essentiel pour se prémunir de la dépression. Selon l’étude, les personnes qui peuvent bénéficier d’une aide émotionnelle, matérielle ou pratique de la part de leur famille, de leurs amis, ou d’une communauté en cas de besoin sont moins sujettes au syndrome dépressif ».
« « Il y en a combien qui souffrent comme cela depuis des années ? » : enquête sur les patients attachés dans les hôpitaux psychiatriques »
Date de publication : 13 janvier 2025
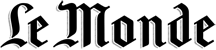
Dans le cadre d’une série d’articles sur « la santé mentale sans consentement », Luc Bronner relève dans Le Monde que « la contention mécanique au sein des hôpitaux psychiatriques constitue l’acte le plus grave de privation de liberté. Son contrôle par la justice demeure limité en raison d’une loi jugée trop complexe, et des réticences d’une partie de la psychiatrie ».
Le journaliste note ainsi : « C’est la loterie du malheur dans le malheur. Celle qui conduit un patient à une chambre d’isolement puis à cet instant où des infirmiers et des aides-soignants d’un service psychiatrique l’immobilisent, lui administrent un sédatif puissant et l’attachent sur un lit avec des sangles de contention en tissu, fixées avec des aimants, pour bloquer les quatre membres ».
« Pour quelques heures, le plus souvent. Pour quelques jours, quelques semaines. Parfois plusieurs mois. La loterie du malheur parce que la probabilité de finir attaché dans une chambre d’isolement varie considérablement d’un hôpital psychiatrique à l’autre, et même d’une unité à une autre », observe Luc Bronner.
Il relève que « certains hôpitaux ne pratiquent plus la contention mécanique, jugée dégradante, inefficace, dangereuse, tandis que d’autres continuent d’y recourir de façon régulière, presque banale, pour les mêmes maladies, les mêmes symptômes ».
Le journaliste continue : « La loterie du malheur parce que les contrôles effectués par la justice sont tout aussi disparates et aléatoires, parfois jamais suivis d’effets. Certains tribunaux ont organisé un suivi régulier de ces mesures extrêmes de privation de liberté, tandis que d’autres les expédient à la va-vite, validant à la chaîne les certificats médicaux ».
Luc Bronner note que « ces pratiques sont légales, mais dissimulées, couvertes à la fois par le secret médical et le secret judiciaire, protégées derrière les portes des unités fermées des hôpitaux, débattues sous le sceau de la confidentialité. Elles ne sont pas si rares : plus de 8000 personnes hospitalisées sans leur consentement au sein de services psychiatriques ont été soumises à des contentions mécaniques en 2022, selon le dernier bilan de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes) ».
Le journaliste précise : « Majoritairement des hommes, plutôt jeunes, généralement hospitalisés pour troubles psychotiques, bipolarité, troubles de la personnalité et du comportement. Des statistiques minimales : les patients peuvent aussi avoir été attachés aux urgences générales pendant des heures, jusqu’à plusieurs jours, dans l’attente de leur prise en charge, sans être comptabilisés officiellement ».
Luc Bronner ajoute que « l’étude de l’Irdes montre qu’une trentaine d’hôpitaux, sur les 220 qui accueillent des patients sans consentement en France, ne pratiquent plus la contention. A l’inverse, 18 hôpitaux dépassent le chiffre très élevé de 20% des malades attachés pendant leur séjour sous contrainte. Le sujet est sensible dans la communauté médicale et conduit à des prises de parole sous condition d’anonymat. Ceux qui s’expriment sont ceux qui ne la pratiquent plus, ou très peu. Ceux qui la pratiquent préfèrent ne pas s’exposer ».
Un « psychiatre expérimenté, ancien responsable d’une unité pour malades difficiles (UMD) », déclare : « Pourquoi ces pratiques doivent-elles choquer ? Parce que les proportions de pathologies qui débouchent classiquement sur de l’isolement et de la contention sont les mêmes partout sur le territoire. Les disparités viennent de différences de prise en charge, pas de la nature des publics ».
Luc Bronner continue : « Les discours sur les supposées vertus thérapeutiques de la contention mécanique ont existé jusqu’à peu dans la vie interne de certains services, mais ils ont disparu de l’argumentaire public. Désormais, c’est le manque de personnel soignant, la sécurité physique des agents, la protection des autres patients qui sont mis en avant pour justifier ces mesures ».
Le Pr Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, remarque que « l’isolement et la contention sont des solutions de dernier recours. Les effets thérapeutiques de ces mesures ne sont pas démontrés, alors que les effets indésirables le sont de plus en plus ».
Luc Bronner indique par ailleurs que « le Conseil constitutionnel avait enjoint au gouvernement d’adopter une loi instaurant ce contrôle, ce qui est devenu effectif en 2022. Mais, de l’avis général – ce qui est rare, autant parmi les psychiatres, les juges que les avocats –, le texte a été adopté dans une telle précipitation, sans réel débat ni évaluation préalable, qu’il est vite apparu brouillon, parfois contradictoire ».
« Pourquoi les nouveaux souvenirs n’effacent pas les anciens »
Date de publication : 15 janvier 2025

Tristan Vey remarque dans Le Figaro que « si «la nuit porte conseil», ce n’est pas sans fondement. C’est pendant notre sommeil que le cerveau fait le tri dans toutes les informations qui ont été recueillies pendant la phase d’éveil ».
Gabrielle Girardeau, chercheuse Inserm et responsable de l’équipe sommeil et mémoire émotionnelle au centre de neurosciences de Sorbonne-Université (NeuroSU), à Paris, indique ainsi : « Nous ne savons pas exactement comment tout cela se déroule précisément, mais certains souvenirs s’effacent tandis que d’autres sont consolidés. […] Nous consolidons à la fois des souvenirs anciens et des expériences nouvelles. Nous pouvons parfois les associer, quand cela est pertinent, mais il ne faut surtout pas mélanger ceux qui ne doivent pas l’être ».
Tristan Vey fait savoir que « dans une publication parue dans la revue Nature, une équipe de neuroscientifiques emmenée par Azahara Oliva et Antonio Fernandez-Ruiz, de l’université Cornell, à Ithaca dans l’État de New York, vient de démontrer que la consolidation des souvenirs anciens ne se faisait pas au même moment que celle des nouveaux (au moins chez la souris, mais il y a de fortes chances pour que cela soit transposable à l’humain) ».
Le journaliste remarque que « parvenir à identifier les sous-phases précises du sommeil pendant lesquelles ces processus se déroulaient constitue une vraie prouesse expérimentale. Les scientifiques ont utilisé un grand nombre de techniques extrêmement sophistiquées ».
Tristan Vey retient que « ces travaux ont plusieurs implications. La première est fondamentale. On distinguait en effet déjà trois phases distinctes de sommeil lent chez l’homme (léger, intermédiaire et profond), ce qui n’était pas le cas chez la souris. Ces travaux montrent qu’il semble bien y avoir aussi une microstructure du sommeil lent chez la souris ».
Karim Benchenane, responsable de l’équipe mémoire, oscillations et état de vigilance au laboratoire de plasticité du cerveau (CNRS, ESPCI, université PSL), à Paris, réagit : « Nous venons justement de déposer récemment sur bioRxiv des résultats – ils ne sont pas encore publiés – qui identifient trois sous-phases potentielles de sommeil profond chez la souris semblant correspondre à celles retrouvées chez l’être humain ».
« On pourrait penser que le sommeil de la souris, qui dort le jour et de manière fragmentée, alors que notre sommeil est nocturne et plutôt d’un seul bloc, est très différent, mais ce n’est probablement pas le cas. Le sommeil est tellement important pour le cerveau qu’il s’est très bien conservé au fil de l’évolution. Toutes les macromolécules qui modifient le sommeil chez le rongeur le modifient d’ailleurs aussi chez l’homme », indique le chercheur.
Damien Claverie, médecin chercheur dans l’unité de neurophysiologie du stress de l’Institut de recherche biomédicale des armées, à Brétigny-sur-Orge, remarque pour sa part que « ces résultats sont passionnants. Cela ouvre notamment des perspectives nouvelles pour la réactivation ciblée de la mémoire, qui est un champ grandissant de prise en charge thérapeutique de l’anxiété ou du stress post-traumatique ».
« « Ce serait très pertinent » : et si les bouteilles d’alcool prévenaient du risque de cancers ? »
Date de publication : 15 janvier 2025

Nicolas Berrod observe dans Le Parisien que « Vivek Murthy, «surgeon general» américain, soit le patron de la Santé publique aux États-Unis, a plaidé […] pour que les bouteilles d’alcool comportent des messages d’avertissement du risque de certains cancers (côlon, sphère ORL, sein, etc.), sur le modèle des paquets de cigarettes ».
Le responsable a ainsi souligné que « le lien direct entre la consommation d’alcool et le risque de cancer est bien établi pour au moins sept types de cancer, quel que soit le type d’alcool (bière, vin, spiritueux, etc.) consommé ».
Le Pr Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse, à Villejuif, confirme : « Vous déclenchez un risque dès le premier verre et plus vous consommez, plus ce risque augmente ».
Nicolas Berrod note qu’« une loi serait nécessaire outre-Atlantique pour modifier les étiquettes actuelles, qui n’ont pas été mises à jour depuis leur instauration en 1988. Et en France ? Un étiquetage « cancers » est demandé depuis longtemps par l’Association Addictions France. […] Mais un tel changement paraît improbable à court terme, tant les résistances et le lobby de l’alcool sont puissants ».
Le Dr Bernard Basset, président d’Addictions France, remarque ainsi que « mieux informer de façon transparente serait très pertinent ».
Nicolas Berrod rappelle qu’« un pictogramme ou une phrase mentionnant les risques pour les femmes enceintes est bien obligatoire sur chaque bouteille alcoolisée depuis 2007, mais les industriels sont parvenus à le rendre tout petit et difficilement visible ».
« Quant à la phrase «l’abus d’alcool est dangereux pour la santé», elle n’apparaît que sur les publicités (depuis 1991). Et ce, sans la moindre précision s’agissant des risques en question », ajoute le journaliste.
Il souligne qu’« en Europe, l’Irlande fait figure de pionnier. Une nouvelle loi adoptée en mai 2023 prévoit qu’à partir de 2026, chaque bouteille d’alcool devra être équipée d’un étiquetage complet indiquant les risques sanitaires. Avec, notamment, un avertissement s’agissant des risques de contracter certains cancers ».
« «L’Irlande montre la voie dans cette initiative d’une importance vitale», selon l’Organisation mondiale de la santé. Celle-ci se dit «prête à soutenir les pays et à collaborer avec eux pour mettre en œuvre des politiques et des interventions en matière d’alcool fondées sur des données probantes» », relève Nicolas Berrod.
« « Blue Monday », le jour le plus déprimant de l’année qui n’est en réalité qu’un concept publicitaire »
Date de publication : 20 janvier 2025
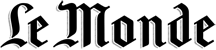

Mathilde Damgé observe dans Le Monde que « depuis une quinzaine d’années, l’expression « Blue Monday » reparaît au mois de janvier sur les réseaux sociaux et dans les médias… Le « lundi le plus déprimant de l’année » tombe cette année le 20 janvier, dans un contexte particulièrement morose ».
La journaliste souligne toutefois que « ce concept, prétendument basé sur les calculs savants d’un psychologue, n’a d’existence que dans l’esprit d’experts en marketing ».
Elle explique ainsi que « le Blue Monday (qui s’inspire de l’expression anglaise to feel blue, « être déprimé ») désignerait de manière irréfutable le troisième lundi de janvier comme le jour le plus déprimant de l’année… selon une prétendue étude scientifique parue en 2005 ».
Mathilde Damgé relève que « cette équation relève plus d’une farce que de l’arithmétique : certains facteurs sont inquantifiables (météo, manque de motivation, etc.). Son auteur, Cliff Arnall, qui se présente comme psychologue, a lui-même admis en 2010 qu’il n’y avait rien de scientifique derrière ce calcul, et qu’il avait été commandé par une société de publicité pour le compte de l’agence de voyages Sky Travel. Ironie de l’histoire, il milite depuis pour son « abolition » dans le cadre d’une campagne sponsorisée par le comité touristique des îles Canaries (Espagne) ».
Dean Burnett, chercheur en neurosciences, a quant à lui déclaré que « ce genre de calculs menace la compréhension que le public a de la science et de la psychologie. C’est également irrespectueux envers ceux qui souffrent de vraie dépression, car cela sous-entend qu’il s’agit d’une expérience temporaire et mineure, dont tout le monde souffre ».
Esther Serrajordia se penche également dans La Croix sur ce « lundi déprime » qui « est au départ une invention purement marketing. Début 2000, une agence de voyages a théorisé l’idée pour tenter d’attirer de nouveaux clients en vendant des séjours au soleil. Depuis, chaque année, le froid, le manque de lumière et la nostalgie du mois des fêtes font du troisième lundi du mois de janvier une journée particulièrement pénible moralement ».
La journaliste relève que « si le Blue Monday reste un concept publicitaire, janvier ne semble pas le mois le plus propice à la joie de vivre ».
Philippe Gabilliet, professeur de psychologie à l’ESCP, indique que « c’est ce qu’on appelle le trouble affectif saisonnier. Nous avons un rapport encore très animal à la nature. Alors quand on se lève, que le temps est mauvais, qu’on manque cruellement de lumière, le moral baisse et l’énergie se perd ».
Esther Serrajordia souligne que « les médecins et les études ne cessent de le dire : l’optimisme est bon pour la santé. Il permet de renforcer notre système immunitaire, fait du bien à notre cerveau et augmente même l’espérance de vie ».
La journaliste s’interroge : « Comment faire pour cultiver sa bonne humeur et garder le moral en plein hiver ? ».
Le Pr Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d’addictologie à l’hôpital Bichat, répond que « d’abord, il faut vérifier que le pessimisme que l’on ressent n’est pas un indice d’une maladie dépressive. Si on n’a plus aucune envie, qu’on se considère comme une mauvaise personne, que la fatigue est la même après un week-end de repos qu’un jeudi matin et que les émotions négatives sont constantes, alors il faut s’interroger. Il est normal d’avoir des accès de pessimisme, mais pas que ces accès soient permanents ».
Le psychiatre ajoute que « tout dans notre nature et dans notre environnement nous pousse à être pessimiste. Beaucoup de personnes rétorquent : “Comment être optimiste alors que les glaciers fondent et que la Californie crame ?“ C’est presque, selon elles, un manque de conscience ou de morale. Je leur réponds : on a le droit d’être triste, mais on n’a pas le droit d’aimer sa tristesse. Cela ne nous rendra pas plus concerné ou intelligent ».
Esther Serrajordia indique que « cultiver l’optimisme nécessite enfin de mettre en place des choses concrètes. À l’unanimité, les spécialistes s’accordent sur les bases à consolider : un bon sommeil, une alimentation équilibrée et de l’exercice physique ».
« Enfants et adolescents autistes : une génération sous cachetons »
Date de publication : 21 janvier 2025

C’est ce que titre Libération, qui observe : « Près de 4 mineurs autistes sur 10 prennent de puissants psychotropes en France, selon un livre à paraître jeudi, qui dévoile une analyse inédite de l’assurance maladie. Derrière cette surmédication, un manque de moyens criant pour prendre en charge ces enfants ».
Rozenn Le Saint relève ainsi : « Antipsychotiques, anxiolytiques, somnifères, sédatifs, antidépresseurs, psychostimulants, antiépileptiques, antiparkinsoniens… Près de 40% des enfants et adolescents autistes prennent au moins un psychotrope en France, selon l’analyse inédite des données de l’assurance maladie à paraître jeudi 23 janvier dans le livre A l’écoute des enfants autistes (éditions du Champs social) ».
La journaliste note que « c’est dix fois plus que les mineurs en général. Ces psychotropes, d’habitude réservés aux adultes, sont massivement prescrits en dehors des clous, sans autorisation de mise sur le marché, pour apaiser les troubles du comportement des enfants atteints de TSA [trouble du spectre de l’autisme]. Il n’existe pas, en soi, de médicament pour ces troubles, qui se caractérisent par des difficultés dans l’interaction et la communication, couplées à des comportements répétitifs et stéréotypés ».
Rozenn Le Saint explique notamment que « chaque enfant autiste consomme environ 19 boîtes de psychotropes par an selon l’ouvrage, le premier à se pencher précisément sur la surmédication de cette population en France. Il a été écrit sous la direction de Sébastien Ponnou, professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris-8-Vincennes-Saint-Denis ».
Ce dernier souligne : « Notre étude montre qu’une fois qu’un psychotrope est prescrit, c’est pour dix ans. Il peut être fait usage d’un médicament en cas d’urgence, si l’enfant s’automutile ou est agressif, mais seul un accompagnement socio-éducatif adéquat aide à long terme à diminuer la souffrance des enfants atteints de TSA ».
Rozenn Le Saint note que « le pédopsychiatre Bruno Falissard, également président de la Société française de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines associées, alerte ». Il déclare que « l’effet des antipsychotiques, c’est le contraire de celui des amphétamines ou de la cocaïne qui rendent speed. Ces médicaments ralentissent, c’est comme si on avait du coton dans la tête. Ça calme mais ça rend aussi déficitaire ».
La journaliste observe en outre qu’« on comptait moins de 600 pédopsychiatres en 2020 dans l’Hexagone. Leur nombre a diminué d’un tiers en une décennie, à mesure que celui d’enfants biberonnés aux psychotropes a augmenté : près de 490.000 enfants étaient sous psychotropes en 2023, soit 70.000 de plus qu’en 2010, selon la toute dernière analyse des chiffres de l’assurance maladie. La hausse pendant la période du Covid-19 s’est poursuivie ensuite. De quoi interroger à l’heure où la santé mentale a été déclarée grande cause nationale par l’ex-gouvernement Barnier ».
« Le burn-out se conjugue au féminin »
Date de publication : 22 janvier 2025
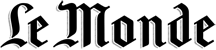
Anne Rodier remarque dans Le Monde que « la valse des chiffres sur la santé mentale au travail continue d’année en année, au fil des études. Qu’ils proviennent des baromètres de l’absentéisme réalisés par les mutualistes, des bulletins de Santé publique France ou des enquêtes de la Fédération des intervenants en risques psychosociaux (FIRPS), ils peuvent être très différents sur la même période et la même population, car ils ne mesurent pas la même chose. Stress, anxiété, tendance dépressive ? ».
La journaliste relève ainsi que « le dernier Baromètre santé mentale du cabinet de conseil en ressources humaines Qualisocial, à paraître jeudi 23 janvier, affiche 25% des 3000 salariés interrogés du 3 au 9 décembre 2024 qui se déclarent en mauvaise santé mentale ».
Jean-Christophe Villette, administrateur de la FIRPS et psychologue du travail et des organisations au cabinet Ekilibre Conseil, souligne que « la dégradation progressive de la santé mentale au travail continue avec une prévalence des troubles plus forte chez les femmes que chez les hommes, dans un rapport d’un pour deux ».
Anne Rodier remarque que « les femmes cadres sont particulièrement concernées. Dans une étude de longue observation de 2013 à 2019, Santé publique France a mesuré que «le risque de signalement d’une souffrance psychique en lien avec le travail augmentait avec la catégorie socioprofessionnelle et atteignait un maximum chez les femmes cadres» ».
La journaliste précise que « l’épuisement professionnel peut être en lien avec les spécificités de l’identité des cadres, explique l’Association pour l’emploi des cadres (APEC) dans sa dernière étude sur le burn-out publiée en décembre 2024 : le fort investissement lié à la fonction menace l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et les cadres peuvent avoir des difficultés à demander de l’aide ».
« Puis parce qu’elles sont particulièrement concernées par les origines multifactorielles de l’épuisement professionnel », ajoute Anne Rodier. Jean-Christophe Villette indique qu’« elles vivent toujours la sursollicitation de la double ou triple journée de travail, en particulier pour les parents isolés ».
Anne Rodier explique en outre que « les femmes sont surreprésentées là où la santé mentale est au plus bas, comme les secteurs en contact avec le public. Le baromètre Qualisocial désigne en bons derniers, avec plus de 30% des salariés interrogés se déclarant en mauvaise santé mentale : l’administration publique, l’hébergement-restauration, l’hébergement médico-social et l’action sociale ».
« Psychiatrie : face à la crise, le Comité d’éthique appelle à l’action »
Date de publication : 28 janvier 2025

Esther Serrajordia note en effet dans La Croix : « Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) l’admet lui-même : on ne compte plus les rapports alertant sur l’état critique de la psychiatrie. Il a pourtant décidé de s’autosaisir et publie […] un avis sur le sujet ».
Le CCNE se dit ainsi « frappé par le nombre important de rapports publiés sur cette psychiatrie à bout de souffle, qui n’ont pas conduit à l’élaboration de solutions pour les professionnels et les patients, et n’ont pas été pris en compte dans les décisions politiques ».
Angèle Consoli, pédopsychiatre et co-rapporteuse, remarque : « On observe un paradoxe troublant. D’un côté, nous sommes confrontés à une offre de soins largement saturée et donc une qualité de soins qui se dégrade faute de moyens adaptés, avec des délais d’attente très long, un manque de médecins, des conditions d’accueil souvent indignes. Et de l’autre, une banalisation, un déni de l’état actuel des soins en psychiatrie ».
Esther Serrajordia note que « la crise du secteur engendre des conséquences éthiques, explique le CCNE. Premièrement, la difficulté à respecter les droits fondamentaux : un certain nombre de soignants ne peuvent pas exercer leurs métiers dans de bonnes conditions et sont parfois contraints à mettre en œuvre des pratiques qui devraient rester exceptionnelles (contention, restriction de la liberté de circulation), ce qui provoque souffrance et déshumanisation ».
« Un autre effet est l’aggravation de la fragilité chez des personnes déjà vulnérables : enfants et adolescents de l’Aide sociale à l’enfance, sans-abri, précaires, détenus… La dernière conséquence est l’instauration d’un «cercle vicieux de la stigmatisation». Faute de réponses solides et durables, la psychiatrie conserve au sein de la communauté médicale une mauvaise réputation », relève la journaliste.
Le CCNE indique que « la mobilisation est donc cruciale car elle reflète aussi notre capacité, en tant que société, à reconnaître et prendre en charge la souffrance psychique dans le respect des principes de liberté, d’équité et de dignité. […] Le temps n’est plus au constat, il faut maintenant des actions ».
Esther Serrajordia précise que le CCNE « appelle à la mise en œuvre rapide d’un «plan» psychiatrie reposant sur trois priorités stratégiques : garantir un accès à des soins dignes ; lutter contre la stigmatisation et l’exclusion des personnes vivant avec des troubles psychiatriques ; renforcer la formation et la recherche dans toutes les disciplines qui concourent à la prise en charge psychiatrique, notamment le paramédical ».
« Retour à la revue de presse.