« « Soigner le corps et l’esprit » : à Nantes, avec une unité psychiatrique au domicile des adolescents »
Date de publication : 6 février 2025

Florence Pagneux explique dans La Croix que « le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) remet [ce] jeudi 6 février, un rapport sur la santé mentale des jeunes, en nette dégradation ». La journaliste observe qu’« à Nantes, un dispositif hors des murs de l’hôpital apporte un soutien intensif à des adolescents en grande souffrance mentale, surtout des jeunes femmes ».
Florence Pagneux explique que « ce dispositif innovant du CHU de Nantes [dénommé EquipaJe] a été inauguré en mars 2023, avec l’objectif de répondre aux besoins de prise en charge rapide de jeunes de 15 à 20 ans en souffrance psychique aiguë : crise suicidaire, mise en danger par des produits toxiques, idées délirantes… ».
La journaliste constate qu’« avec ses 6 places et une file d’attente permanente, cette unité ne vient pas pallier le manque chronique de places en psychiatrie dans le département, historiquement sous-doté, mais répondre – sous 48 à 72 heures – aux situations les plus urgentes, adressées par un médecin ».
Florence Pagneux indique que « des objectifs simples et gradués sont fixés avec le patient pour l’aider à reprendre pied (sortir de son lit, prendre un vrai repas, aller marcher dehors…). Un plan est aussi élaboré pour réagir en cas de crise : prendre un bain, taper dans un punching-ball, appeler un proche… ».
« L’accompagnement quasi quotidien, assuré par une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, infirmiers, psychologue, assistante sociale, psychomotricienne, socio-esthéticienne…), a lieu dans les locaux de l’unité et au domicile du jeune », poursuit-elle.
La journaliste note par ailleurs que « les jeunes hommes ne représentent que 22% de la centaine de patients déjà suivis par l’unité. Si la crise du Covid et la pression scolaire ont contribué à la dégradation de la santé mentale des adolescents, les filles sont surreprésentées dans les passages aux urgences psychiatriques ».
Thibault Desrues, psychiatre coordonnateur d’EquipaJe, remarque ainsi que « la fréquence des agressions sexuelles subies par les jeunes filles est vraiment quelque chose de marquant. Avant [le mouvement #MeToo], ces choses-là étaient tues ».
« Des scientifiques pensent avoir découvert comment le cerveau surmonte la peur »
Date de publication : 10 février 2025

Libération publie un article paru dans le Washington Post, relevant que « des chercheurs ont identifié le mécanisme par lequel les souris dépassent leurs peurs instinctives, ce qui pourrait aider la recherche pour le traitement de patients souffrant d’anxiété et de phobies ».
Leo Sands explique ainsi : « Des scientifiques affirment avoir identifié la manière dont le cerveau surmonte une peur instinctive, offrant ainsi des pistes pouvant être utiles aux personnes qui luttent contre des troubles liés à la peur, notamment les phobies, l’anxiété et le syndrome de stress post-traumatique ».
Le journaliste précise que « les chercheurs britanniques ont exposé des souris à des scénarios inoffensifs répétés, qui imitaient un danger, et ont observé comment elles ont fini par apprendre à mettre leurs peurs de côté. Ce qui a permis de comprendre comment le cerveau des mammifères apprend à garder son calme et à continuer normalement face à une menace infondée ».
« Selon l’étude, puisque les souris et les humains partagent des circuits neuronaux analogues, les résultats pourraient indiquer aux chercheurs en médecine où, dans le cerveau humain, cibler les traitements pour les troubles liés à la peur », poursuit-il.
Leo Sands indique que « les scientifiques ont étudié la réaction d’une centaine de souris face à une menace visuelle répétée qui s’est avérée inoffensive au fil du temps. […] En insérant des sondes en silicium dans le cerveau des souris, les auteurs de l’étude ont pu suivre les mécanismes neuronaux qui s’allument lorsque les mammifères apprennent à supprimer leur peur ».
« L’étude a permis d’identifier l’endroit où le cerveau stocke les souvenirs permettant d’ignorer les peurs instinctives : une zone jusqu’alors peu explorée, connue sous le nom de corps géniculé latéral ventral [proche du thalamus, ndlr] », note le journaliste.
Il retient qu’« en comprenant les structures du cerveau activées par le processus de désapprentissage, la recherche pourrait s’avérer bénéfique pour aider à surmonter les troubles liés à la peur. […] Les chercheurs en médecine pourraient cibler les mêmes circuits dans le cerveau humain par le biais d’interventions thérapeutiques telles que les médicaments, la stimulation cérébrale profonde ou les ultrasons fonctionnels ».
Sara Mederos, neuroscientifique au Sainsbury Wellcome Center de l’University College de Londres, qui a mené ce travail, remarque que « le ciblage de zones cérébrales comme le noyau géniculé latéral ventral pourrait ouvrir de nouvelles voies pour traiter ces troubles ».
Leo Sands ajoute que « l’étude montre également comment des molécules spécifiques, transmises par des neurotransmetteurs, sont libérées dans cette zone du cerveau et permettent d’apprendre à ne plus avoir peur ».
Sara Mederos indique que « des médicaments particuliers ciblant spécifiquement cette zone pourraient aider à traiter l’anxiété ou le syndrome de stress post-traumatique ».
« Trouble mental : moins d’une personne sur dix reçoit un traitement adapté »
Date de publication : 11 février 2025

Alissa de Chassey constate dans Le Figaro qu’« à l’échelle mondiale, seulement 6,9% des personnes atteintes de troubles mentaux ou de dépendances reçoivent un traitement efficace, d’après une étude de l’Université de la Colombie Britannique et de l’école de médecine de Harvard ».
La journaliste explique ainsi que « les chercheurs ont récolté des données sur 19 ans, auprès de 57.000 participants de 21 pays [dont la France]. L’objectif ? Identifier à quelle étape du parcours de soins les patients cessent de rechercher un traitement efficace et les raisons de cet abandon ».
Le Pr Pierre-Michel Llorca, chef du service de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand, remarque que « les indicateurs entre les différents pays sont particulièrement intéressants, car ils apportent des informations essentielles pour encadrer les politiques publiques de santé et orienter les stratégies d’intervention ».
Alissa de Chassey relève que « les chercheurs se sont penchés sur les troubles anxieux, les troubles de l’humeur (trouble dépressif et trouble bipolaire par exemple) ainsi que sur les troubles liés à l’usage de substances (comme l’alcool et les drogues) ».
La journaliste note que « la prise en charge de certains troubles peut parfois varier considérablement dans la même catégorie. Par exemple, la dépression majeure est bien mieux prise en charge que les troubles bipolaires, qui restent largement sous-traités ».
Alissa de Chassey indique que « selon les chercheurs, 4 étapes clés mènent à un traitement efficace, chacune présentant des obstacles. Le premier est la difficulté des personnes concernées à reconnaître qu’elles ont besoin d’un traitement. […] Seules 46,5% des personnes répondant aux critères d’un trouble reconnaissent avoir besoin d’un traitement ».
« Parmi ceux qui reconnaissent leur besoin, 34,1% seulement se tournent vers le système médical. 82,9% de ces derniers vont recevoir un traitement, mais seuls 47% obtiennent un traitement réellement efficace. […] Pour le moment, en raison des abandons à chaque étape, seuls 6,9% des patients finissent donc par bénéficier d’un traitement adapté », continue la journaliste.
Elle évoque en outre « le besoin de former les médecins généralistes » : « L’étude révèle une forte diminution du nombre de patients après leur premier contact avec le système de santé, avant même d’obtenir un traitement efficace. Étant donné que les médecins généralistes sont souvent le premier interlocuteur, leur formation joue un rôle clé dans l’amélioration de la prise en charge ».
Alissa de Chassey rappelle qu’« en France, une nouvelle maquette de formation du diplôme d’étude spécialisée de médecine générale, datant de 2023, a fait de la santé mentale une thématique prioritaire pour le stage libre introduit dans la phase d’approfondissement ».
Le Pr Llorca note qu’« il est encore un peu tôt pour noter une nette amélioration, mais il est essentiel de trouver le bon équilibre, et cette maquette y participe : les médecins généralistes ne peuvent pas être spécialistes de toutes les pathologies, mais renforcer leurs connaissances et leur vigilance est cruciale pour mieux repérer les troubles mentaux ».
« Des neurones activés pour vous ordonner d’arrêter de manger »
Date de publication : 12 février 2025

Alissa de Chassey explique dans Le Figaro que « lorsque l’odeur d’un repas vous met en appétit, certains neurones s’activent déjà pour vous indiquer… d’arrêter de manger. Des chercheurs de l’université de Columbia, à New York, ont identifié chez les souris ces « neurones CCK » situés dans le raphé dorsal (DRN), à la base du cerveau ».
Carmelo Quarta, chercheur en neurobiologie au Neurocentre Magendie de Bordeaux (Inserm), souligne en effet que « c’est une région dont le rôle dans la sensation de satiété et la satiation reste encore peu connu, ce qui rend cette découverte particulièrement précieuse ».
La journaliste note que « bien que ces neurones aient été découverts chez la souris, leur emplacement dans le tronc cérébral, une structure quasi identique chez tous les vertébrés, suggère qu’ils existent aussi chez l’homme ».
Alissa de Chassey retient que « l’activation de ces neurones CCK liés aux voies moléculaires de la régulation de l’énergie et du métabolisme permet de réduire fortement et rapidement la prise alimentaire de la souris. Leur activité augmente dès la première bouchée et reste élevée pendant tout le repas, indiquant à la souris que son estomac se remplit ».
La journaliste ajoute qu’« après la dernière bouchée, cette activité diminue progressivement en environ 10 secondes. Imposant aux souris un délai de 30 secondes entre chaque bouchée, les chercheurs ont observé que l’activité neuronale retournait rapidement à son niveau de base entre deux bouchées, confirmant que les neurones CCK réagissent bien à chaque prise alimentaire de façon individuelle, ce qui réduit progressivement la quantité de nourriture que la souris va prendre. Si on stimule artificiellement les neurones CCK avant le début du repas, cela entraîne une réduction de l’appétit général de la souris ».
Le Dr Srikanta Chowdhury, qui a mené ce travail, précise que « la ghréline, l’hormone de la faim, inhibe l’activité des neurones CCK ».
Alissa de Chassey note ainsi : « Les chercheurs estiment que cette découverte pourrait faire avancer les traitements contre l’obésité. Celle-ci est «multifactorielle», rappelle Carmelo Quarta, mais les auteurs pensent que «ces résultats pourraient ouvrir la voie à une régulation du comportement alimentaire» ».
« Crise de la psychiatrie : « au CHU de Saint-Etienne, les patients risquent de se mettre en danger » »
Date de publication : 12 février 2025

Maïté Darnault constate dans Libération que « la fermeture, cette semaine, d’une unité du pôle de psychiatrie de l’établissement stéphanois, dédiée aux plus vulnérables, inquiète patients et soignants, qui redoutent de «devoir faire plus de boulot avec moins de moyens» et y voient le signe d’un «démantèlement de la psychiatrie publique» ».
La journaliste livre ainsi un reportage au sein du CHU de Saint-Etienne : « Ce 4 février, une centaine de soignants sont réunis près d’un petit barnum et d’une sono qui crache quelques tubes de manifestation. Ils ont répondu à l’appel à la grève lancé par la CGT et FO pour protester contre la fermeture d’une unité d’admission du pôle de psychiatrie – l’UA4, l’une des 7 que compte le principal hôpital de la Loire ».
Maïté Darnault relève que « mi-janvier, l’annonce de la suspension de l’unité par la direction de l’hôpital a pris de court les salariés et généré de l’inquiétude au sein de la population du bassin stéphanois, où l’attente moyenne pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique, la première porte d’entrée en cas de difficultés psychiques, va de 6 à 8 mois ».
La journaliste explique notamment qu’« après la fermeture de l’UA4, le pôle de psychiatrie disposera de 163 lits, contre 191 en 2019, selon la direction du CHU. Or sur cette même période, les files actives sont restées stables chaque année, en ambulatoire (les admissions de jour, autour de 11.400 patients) comme en hospitalisation complète (les séjours incluant des nuitées, près de 2000 patients). En dix ans, de 2014 à 2024, l’effectif du pôle a augmenté, passant de 44 à 56 médecins et de 620 à 633 personnels non médicaux ».
« Moins de lits pour autant de patients, avec plus de médecins : l’équation témoigne d’abord de l’incantation au «virage ambulatoire», «maître mot des réformes de la politique hospitalière» depuis une quinzaine d’années, pointe Fanny Vincent, politiste et maîtresse de conférences à l’université de Saint-Etienne », continue la journaliste.
Fanny Vincent explique que « cela répond à deux arguments : le fait de rendre l’hôpital plus performant car le progrès médical permettrait de prendre en charge des patients avec la même qualité de soins qu’en hospitalisation complète, et le fait que les gens préféreraient être chez eux qu’à l’hôpital. Il y a aussi un objectif financier parfois clairement énoncé : ça coûte moins cher de prendre des gens sans payer des lits et des équipes de nuit ».
Maïté Darnault poursuit : « Se dessine alors «de plus en plus un lieu de soins et plus du tout un lieu d’accueil». Alors qu’en psychiatrie, «il y a une mission sociale d’accueil, d’écoute et la nécessité de prendre du temps dans certaines prises en charge, ce que l’hôpital n’assume plus» ».
Olivier Bossard, directeur général et président du directoire du CHU, précise : « Ces éléments de variation sont liés à la disponibilité des ressources, non pas à une volonté machiavélique de réduire le capacitaire. On va conserver les locaux avec l’espoir de recruter et si on trouve des médecins qui sont d’accord pour exercer en hospitalisation complète [séjours avec nuitées], on rouvrira immédiatement ».
La journaliste souligne que « depuis plusieurs années, la psychiatrie est l’une des spécialités les moins demandées par les étudiants en médecine ». Isabelle, infirmière dans une équipe mobile de psychiatrie du CHU, déclare que « beaucoup d’internes qui arrivent très pro-psychiatrie publique sont broyés par les contraintes horaires, les responsabilités qui leur incombent, ils partent par dégoût et épuisement. On veut nous faire croire que c’est une question financière mais c’est beaucoup dû au fait de ne pas pouvoir faire leur travail avec le sens qu’ils veulent y mettre ».
Maïté Darnault relève que « désormais, les patients sans consentement de Saint-Etienne seront répartis dans d’autres unités du CHU. La direction s’est également engagée à «mettre en place en substitution un dispositif d’«aller vers» et d’hospitalisation à domicile dans les lieux de vie des personnes, avec une équipe mobile», détaille Olivier Bossard. Il viendrait renforcer celle qui existe déjà et que les patients comme les familles «apprécient beaucoup», salue Jean-Claude Mazzini, à l’Unafam ».
« Le calvaire invisible des jeunes aidants : « Pour certains enfants, c’est leur normalité » »
Date de publication : 19 février 2025

Bérangère Lepetit publie dans Le Parisien un reportage sur ces « adolescents ou jeunes adultes qui s’occupent d’un parent malade [et qui] seraient 12% au collège, 14% au lycée, plus de 16% à la fac. Des responsabilités qui pèsent lourd dans leur vie de tous les jours ».
La journaliste explique que « tout commence par de petites tâches, parfois dès le plus jeune âge. Accompagner son frère ou son père aux toilettes. Faire la cuisine, la vaisselle. Écouter, beaucoup. Au fil du temps, les responsabilités pèsent plus lourd sur leurs épaules. Il y a les coups de fil à passer, les courses à ne pas oublier, les navettes quotidiennes à la pharmacie ».
Françoise Elien, psychologue et fondatrice de l’association Jade, indique que « le jeune aidant est celui qui apporte une aide régulière, un soutien moral à un proche atteint d’une maladie chronique, somatique, d’un handicap ou encore d’une pathologie psychiatrique ».
Bérangère Lepetit note ainsi qu’« en France, une poignée de structures se sont créées pour tenter d’alléger la charge de ces soutiens familiaux âgés de moins de 25 ans. Ils peuvent être « aidants directs » — venir directement accompagner un proche — ou « indirects », c’est-à-dire en soutien de l’aidant principal ».
La journaliste retient « un constat : leur nombre augmente en même temps que la fréquence des maladies chroniques et des cancers, au rythme aussi des incitations toujours plus grandes des pouvoirs publics au maintien à domicile des malades. »
« Quand une pathologie frappe, ce sont des familles entières qui se retrouvent, malgré elles, plongées dans le soin. À ce détail près qu’un aidant sur trois s’ignore. […] Nombreux, en effet, sont ceux qui n’ont aucune conscience de leur statut, ce qui rend d’autant plus épineuse la première tâche des associations : les identifier », remarque Bérangère Lepetit.
Morgane Hiron, déléguée générale du collectif Je t’aide, souligne que « quand on est jeune, on n’est pas encore construit. Pour certains enfants notamment, c’est leur normalité, ils n’ont connu que ça ».
Bérangère Lepetit ajoute : « En première ligne, les filles, mais aussi les enfants grandis dans des familles monoparentales. […] Ces jeunes ne vivent définitivement pas une vie de leur âge, ils se sentent beaucoup plus isolés que les autres ».
La journaliste constate de plus que « peu de dispositifs d’aide existent pour eux, à part de rares aménagements du temps scolaire ou universitaire et la possibilité pour les étudiants aidants d’acquérir des points dans le cadre d’une demande de bourse sur critères sociaux ».
Morgane Hiron déclare que « l’un des enjeux majeurs reste aussi de revaloriser les emplois à domicile, mieux rémunérer les auxiliaires de vie, les soignants. Cela éviterait à ces jeunes de devoir par endroits faire les pansements de leurs parents ».
« « Tout le monde en achète, les jeunes aussi ! » : enquête sur le dangereux business des aphrodisiaques »
Date de publication : 20 février 2025

Le Parisien indique en effet : « Viagra dissimulé dans des boissons vendues en épicerie, contrefaçons disponibles en sex-shop, génériques achetés en pharmacie sans ordonnance, crème « retardante » ou bonbons énergisants suspects… Enquête sur le marché illégal de la libido ».
Vincent Mongaillard, Elsa Mari et Victoire Haffreingue-Moulart livrent ainsi une enquête sur le sujet, constatant qu’« en France, il est facile de se procurer du faux Viagra «100% naturel » dans des commerces ayant pignon sur rue. Sous les projecteurs ces dernières semaines à la suite de l’explosion des saisies par les douanes (…), le miel aphrodisiaque est loin d’être le seul antidote interdit contre les troubles de l’érection. Ces sticks arrivés par conteneurs de Malaisie, aux noms aguicheurs comme « Black Horse » et « Jaguar Power » sont coupés, eux aussi, au sildénafil ».
Cyrille Guillot-Tantay, chirurgien urologue à l’hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine), rappelle qu’« il s’agit d’un médicament sur prescription avec des contre-indications cardiaques ».
Les journalistes continuent : « Des boissons, poudres, bonbons, chocolats… aux graves effets indésirables nourrissent aussi ce gigantesque marché illégal de la libido. Cinq mois avant leur rappel en France, l’Attoté et ses petites sœurs avaient été bannis en Côte d’Ivoire après des tests révélant la détection «d’importantes quantités de sildénafil» ».
Ils relèvent notamment qu’« en 2023, le CHU de Bordeaux avait analysé le liquide ocre d’Attoté et conclu que deux verres à thé, la posologie quotidienne indiquée, équivalaient à l’ingestion de 380 mg de sildénafil alors que la dose recommandée de ce vasodilatateur oscille entre 50 et 100 mg ».
« Ce surdosage peut provoquer des maux de tête, des vertiges et, chez les consommateurs hypertendus ou présentant des risques cardiovasculaires, des AVC (accident vasculaire cérébral) et des infarctus », soulignent les journalistes.
Le Dr Guillot-Tantay indique que « même pour une personne lambda, une vasodilatation extrême peut entraîner un malaise cardiaque ».
Vincent Mongaillard, Elsa Mari et Victoire Haffreingue-Moulart notent que ces produits « ont fait l’objet, selon le ministère de l’Agriculture, d’un retrait après leur «découverte dans des épiceries exotiques, à l’occasion de contrôles par les agents de la DGAL». Mais visiblement, beaucoup de magasins sont passés à travers les mailles du filet ».
Les journalistes précisent qu’« à la Direction générale des douanes, on explique que «la problématique des principes actifs, sildénafil et tadalafil, est concentrée sur les miels aphrodisiaques», ses «services ne procédant pas à ce type de saisie» concernant «les autres produits alimentaires» susceptibles de contenir ces substances ».
Ils ajoutent : « Nul besoin de faire les boutiques pour dénicher tous ces excitants. Sur des sites en ligne semblables à n’importe quelle plate-forme commerciale, on peut aussi faire son marché parmi une foultitude d’offres. Au menu, des bonbecs censés booster l’érection, goût café ou menthe, le désormais célèbre miel aphrodisiaque (vendu entre 9 et 10 euros), de l’huile de sangsue et des onguents pour «agrandir et élargir» le pénis (entre 25 et 45 euros). On y trouve aussi pour 20 euros des «crèmes retardantes» ciblant les éjaculateurs précoces ».
Vincent Mongaillard, Elsa Mari et Victoire Haffreingue-Moulart concluent qu’« aux yeux de l’urologue Cyrille Guillot-Tantay, tous ces mélanges à base de plantes semblent «inoffensifs» mais «ne servent à rien» ».
Le médecin explique que « la phytothérapie ne marche pas pour soigner les troubles de l’érection, je n’en ai jamais prescrit à mes patients », ajoutant : « Je ne pensais pas qu’il y avait autant de choses sur le marché ! »
« L’enfance maltraitée, un enjeu sanitaire : « On doit pouvoir la traiter comme une maladie chronique, pleinement pédiatrique » »
Date de publication : 20 février 2025
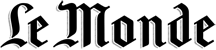
Mattea Battaglia explique dans Le Monde que « les enfants victimes de violences accumulent les risques, perdant 20 ans d’espérance de vie par rapport à la population générale. Leur prise en charge s’est améliorée, notamment grâce aux unités d’accueil pédiatrique pour l’enfance en danger, mais elle reste insuffisante ».
La journaliste rappelle que « l’évaluation médico-sociale de tout jeune intégrant un dispositif de protection de l’enfance (ils sont un peu moins de 400.000 mineurs ou majeurs de moins de 21 ans) est entrée dans la loi en 2016. Pourtant, dans les faits, seuls 28% des conseils départementaux auraient rendu ce bilan systématique, selon des statistiques reprises par la Haute Autorité de santé. Moins du tiers des enfants «à protéger» bénéficieraient des bilans adéquats dès leur admission et, parmi eux, seul 1 sur 10 bénéficie du suivi adapté par la suite ».
« Un autre chiffre, emprunté à une étude européenne, et relayé par le Conseil économique, social et environnemental dans un avis diffusé à l’automne 2024, symbolise ce que les soignants résument sous la formule «pertes de chances» : les victimes de maltraitances dans l’enfance ont, en moyenne, une espérance de vie inférieure de 20 ans à celle de la population générale », souligne Mattea Battaglia.
Elle cite notamment la Pre Céline Greco, « à l’initiative d’équipes mobiles à l’hôpital chargées de repérer les enfants victimes de violences »,qui déclare : « Lorsqu’ils subissent des violences graves à la maison, ces enfants vivent un Bataclan tous les soirs, avec une peur réelle de mourir sous les coups ».
Mattea Battaglia poursuit : « Celle qui dirige aujourd’hui le service de médecine de la douleur et palliative à l’hôpital Necker, à Paris, convoque, lorsqu’on l’interroge sur le sujet, une autre image inattendue : une «attaque d’ours» ».
La Pre Greco explique : « Imaginez que vous croisiez un ours dans la forêt. Votre cerveau ordonne à vos glandes surrénales de sécréter de l’adrénaline et du cortisol. Ces hormones du stress provoquent une tachycardie, une augmentation de la tension artérielle, une modification de la respiration pour amener plus de sang vers vos muscles et pouvoir combattre ou fuir l’ours ».
« Le foie libère du glucose, source d’énergie, tandis que le système digestif et immunitaire se met au repos. Après avoir combattu ou fui l’ours, un thermostat interne stoppe la sécrétion d’adrénaline et de cortisol, et le corps revient à son état de base », continue la praticienne.
Mattea Battaglia remarque : « Mais que se passe-t-il si l’« ours » rentre à la maison chaque soir ? ». Céline Greco répond que « le thermostat ne fonctionne plus, l’adrénaline et le cortisol sont sécrétés en permanence et le stress chronique devient toxique pour l’organisme en développement. Ce mécanisme explique les conséquences des violences faites aux enfants sur leur santé future ».
La journaliste indique ainsi qu’« un enfant maltraité présente, à l’âge adulte, deux fois plus de risques de développer des maladies cardio-vasculaires, deux à trois fois plus de risques de maladies respiratoires, deux fois plus de risques de cancers, près de cinq fois plus de risques de dépression, trente-deux fois plus de risques de troubles des apprentissages… ».
Mattea Battaglia note que « les acteurs de terrain s’accordent sur un point : il faut un «regard pluridisciplinaire». Pouvoir «croiser les expertises», ce qui manque souvent dans les espaces fréquentés par les enfants, qu’il s’agisse de l’école ou du cabinet du médecin traitant. Une unité d’accueil comme l’UAPED [unité d’accueil pédiatrique pour l’enfance en danger], elle, le permet : c’est ce qui fait la spécificité de ces dispositifs aujourd’hui implantés dans une centaine de départements et dans près de 140 hôpitaux, […] pour organiser le repérage et la prise en charge des mineurs victimes ».
Tania Ikowsky, pédiatre à l’hôpital Robert-Debré (Paris), déclare ainsi : « On doit pouvoir traiter la maltraitance comme une maladie chronique, pleinement pédiatrique, en tenant compte des facteurs de risque, donc, mais aussi d’une prévalence très élevée – 1 enfant sur 10 serait victime de négligence ou de maltraitance –, et en prenant en charge, dans une approche globale, les conséquences sur la santé ».
« Les effets bénéfiques [du sémaglutide] sur la dépendance à l’alcool se confirment »
Date de publication : 21 février 2025

Marie Parra indique dans Sciences et Avenir qu’« une nouvelle étude tend à confirmer les effets des analogues de GLP-1, tels qu’Ozempic ou Wegovy, sur la dépendance à l’alcool. Diminution de l’envie et de la consommation : les résultats sur cette petite cohorte sont encourageants. [L’hormone intestinale] GLP-1 agirait notamment sur le système de récompense ».
La journaliste explique que « dès les études précliniques des années 2010, les scientifiques constatent que GLP-1 peut désamorcer les comportements addictifs. Mais jusqu’à présent, les travaux sur l’être humain étaient rétrospectifs : les chercheurs examinent le dossier des patients auxquels on a prescrit des analogues de GLP-1 pour traiter un diabète par exemple, et observent l’évolution d’un comportement, tel que l’addiction ».
Nicolas Marie, chercheur au CNRS, précise que « cette fois-ci, les scientifiques de l’Université de Californie du Sud font un pas en avant avec un essai contrôlé randomisé ».
Marie Parra relève ainsi que « l’objet de l’étude est la dépendance à l’alcool, et la molécule a été administrée pour analyser ses effets sur ce comportement et non sur l’obésité ou le diabète. En d’autres termes, l’addiction est observée en elle-même et pas en tant qu’effet secondaire. Leurs résultats ont été publiés dans la revue JAMA Psychiatry ».
La journaliste rappelle que « le sémaglutide avait fait l’objet d’une étude rétrospective d’ampleur en mai 2024. Elle explorait justement les effets de cette molécule sur la dépendance à l’alcool. L’analyse des dossiers médicaux de 80.000 personnes obèses avait révélé une diminution de moitié de leur consommation. Cette fois-ci, des chercheurs ont réuni une petite cohorte d’une cinquantaine d’adultes souffrant de troubles modérés liés à la consommation d’alcool et qui ne recherchaient pas activement de traitement ».
Les auteurs indiquent qu’« au cours du mois précédent, les participants avaient consommé plus de 7 verres par semaine pour les femmes, et plus de 14 pour les hommes. Ils avaient aussi vécu deux épisodes ou plus de forte consommation d’alcool ».
Marie Parra relève qu’« ils ont ensuite été répartis en deux groupes, certains ont reçu des injections hebdomadaires d’une dose standard d’Ozempic, pour les autres, il s’agissait d’un placebo. Après 9 semaines, les chercheurs ont renseigné leur consommation d’alcool en mesurant notamment la concentration d’alcool dans l’haleine ».
Nicolas Marie constate que « le sémaglutide a réduit de manière significative la consommation des participants ainsi [que] les « cravings » d’alcool, c’est-à-dire les envies irrépressibles ».
La journaliste retient que « près de 40% des personnes traitées par Ozempic n’ont signalé aucun jour de forte consommation d’alcool au cours du dernier mois de traitement, contre 20% dans le groupe placebo ».
Marie Parra explique que « si cette molécule peut avoir un effet sur les addictions, c’est que GLP-1 agit largement dans le cerveau, en particulier sur le circuit de la récompense. […] GLP-1 inhibe ainsi la compulsion et la recherche de récompense. D’après les auteurs de l’étude, le sémaglutide serait au moins aussi efficace que la naltrexone, actuellement prescrit pour lutter contre la dépendance à l’alcool ».
La journaliste note en outre que « les fumeurs qui faisaient partie du groupe Ozempic ont aussi diminué leur consommation de cigarettes. De nouvelles études sont attendues pour continuer d’explorer les effets de ces molécules sur les addictions et la dépression notamment ».
« Retour à la revue de presse.