« Le bruit est nocif pour la santé : ces métiers toujours beaucoup trop exposés »
Date de publication : 1er avril 2025

Nicolas Berrod constate dans Le Parisien que « beaucoup trop de travailleurs restent exposés à un niveau sonore potentiellement dangereux pour la santé, d’après une étude inédite de Santé publique France ».
Le journaliste souligne que « les risques sont multiples : troubles de l’audition (acouphènes, surdité, etc.), mais aussi stress, problèmes de sommeil, maladies cardiovasculaires… ».
Il explique ainsi que « les experts de l’agence sanitaire ont analysé le niveau d’exposition au bruit, c’est-à-dire «le niveau sonore moyen auquel une personne est potentiellement exposée» pendant une journée de 8 heures de travail, en France ».
Nicolas Berrod retient que « plus de 5 millions de travailleurs, soit 20,5% du total, étaient exposés à un bruit moyen d’au moins 70 décibels (dB) en 2019. Cette part a légèrement diminué depuis 2007, lorsqu’elle atteignait près de 23% ».
Le journaliste remarque que « cette petite baisse est en trompe-l’œil ! Elle s’explique par la chute du nombre de professionnels dans les métiers les plus exposés, notamment en métallurgie (passée de plus de 110.000 à moins de 90.000 employés en 12 ans) ».
Il continue : « Ces victimes de nuisances sonores sont en très grande majorité des hommes et plus d’un tiers d’entre elles subissent même un bruit moyen d’au moins 80 dB, soit l’équivalent d’une tondeuse à gazon. À partir d’un tel niveau, dit «lésionnel», on considère que l’ouïe est en danger ».
Nicolas Berrod ajoute que « l’étude s’est penchée (…) sur les différents secteurs professionnels. Celui qui regroupe le plus de travailleurs en proie à du bruit important est le BTP (1,3 million, dont plus de 700.000 qui subissent au moins 80 dB en moyenne) ».
« Mais quand on rapporte le nombre de victimes potentielles à celui d’employés, c’est le secteur «mécanique et travail des métaux» (ouvriers, techniciens, etc.) qui est le plus touché : près de 80% de professionnels exposés, et plus de la moitié à du bruit «lésionnel» »,relève-t-il.
Le journaliste note que « les experts de Santé publique France espèrent que leurs résultats permettront d’«orienter au mieux la prévention, en ciblant les secteurs avec le plus de personnes concernées ou avec les plus fortes proportions d’exposés» ».
Nicolas Berrod rappelle qu’« à partir de 80 dB en moyenne, la réglementation française prévoit la possibilité de faire examiner son audition par un médecin, sur demande du travailleur. Au-delà de 85, les endroits bruyants doivent être signalés comme tels, leurs accès doivent être limités, et des protecteurs auditifs ainsi qu’une surveillance médicale renforcée doivent être proposés aux employés ».
« Une fois que l’on dépasse – théoriquement – le seuil de 87, l’entreprise doit obligatoirement prendre des mesures pour réduire le bruit », ajoute le journaliste.
La Dr Jocelyne Berthaud, médecin coordinateur chez Horizon Santé Travail, remarque pour sa part que « des progrès ont été faits, notamment par les entreprises de BTP qui font très attention et qui mettent à disposition des casques. Mais encore faut-il que ces derniers soient correctement mis ! Et il faudrait aussi des machines moins bruyantes, comme on l’a fait dans l’automobile avec les voitures électriques ».
« Le stress peut-il provoquer un arrêt cardiaque ? »
Date de publication : 7 avril 2025

C’est ce que se demande Cécile Thibert dans Le Figaro, qui note : « Colère, déception amoureuse, pression intense… peuvent déséquilibrer notre organisme ».
Le Pr Christophe Scavée, cardiologue aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, remarque ainsi que « le lien entre stress et risque d’arrêt cardiaque est connu depuis longtemps, mais l’étude la plus connue date de 2004 ».
Cécile Thibert rappelle que « cette étude (appelée « Interheart ») portant sur 25.000 personnes à travers le monde avait non seulement montré que le stress augmente le risque d’infarctus du myocarde, mais aussi qu’il existe un effet dose : plus le stress est prolongé, plus le risque est grand ».
« De nombreuses études ont confirmé ce résultat. Après le tabac et le diabète, le stress constituerait ainsi le troisième facteur de risque évitable d’accident cardiaque », relève la journaliste.
La journaliste cite l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, qui précise que le stress est un état qui « survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ».
Sébastien Tubau, psychologue clinicien en Suisse, déclare quant à lui que le stress « est l’ensemble des réactions physiologiques et psychologiques que l’individu développe face à un danger ».
Cécile Thibert continue : « Il faut distinguer le stress aigu, causé par une circonstance exceptionnelle, et le stress chronique ».
Le Pr Scavée indique que « dans le premier cas, l’organisme produit immédiatement de l’adrénaline, explique. Cette substance, qui est l’hormone du stress par excellence, a un effet direct sur la fréquence cardiaque et la tension artérielle ».
La journaliste note que « les artères se contractent alors qu’au même moment, le cœur requiert un apport accru en oxygène. Autant d’événements qui peuvent provoquer un défaut d’alimentation en sang du cœur ».
Cécile Thibert remarque qu’« il existe aussi le syndrome du « cœur brisé » (ou « tako-tsubo », décrit au Japon dans les années 1990), qui survient après un lourd choc émotionnel et qui ressemble à une crise cardiaque (mais ce n’en est pas une) ».
« Le syndrome est dû à la déformation du ventricule gauche du cœur, qui n’arrive alors plus à assurer sa fonction de pompe, entraînant de ce fait une insuffisance cardiaque. Touchant en grande majorité les femmes, le tako-tsubo serait responsable de 1% à 3% des accidents cardiaques », précise la journaliste.
Elle explique en outre que le stress chronique « est plus insidieux et s’installe sur le long terme ».
Le Pr Scavée indique que « le niveau de cortisol est très élevé. Cette hormone est indispensable mais, en excès, elle a un effet néfaste sur le cœur, la tension artérielle, les vaisseaux sanguins et elle aggrave les dépôts de cholestérol dans les artères ».
Cécile Thibert note que « d’après l’Association française de cardiologie, environ 3,5% des infarctus du myocarde seraient induits par un stress professionnel chronique, soit 3500 à 4000 cas chaque année ».
La journaliste s’interroge enfin : « Comment atténuer son stress pour diminuer son risque cardio-vasculaire ? ». Sébastien Tubau répond : «J’utilise beaucoup une technique de respiration appelée “cohérence cardiaque”. Cela va agir sur la fréquence cardiaque qui est un paramètre relié au système nerveux automne. Très rapidement, le cerveau va s’aligner et moduler sa réponse au stress. En quelques semaines, on peut diminuer l’anxiété, parmi d’autres choses ».
Cécile Thibert ajoute que « l’activité physique, les thérapies cognitives et une bonne alimentation sont également des alliés contre le stress ».
« Addictions, tentatives de suicide, urgences médicales : comment les détenus sont soignés en prison »
Date de publication : 7 avril 2025

C’est ce que titre Le Parisien, qui explique qu’« en dehors des horaires d’ouverture de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Beauvais (Oise), les prisonniers peuvent être conduits à l’hôpital sous escorte. Pour réduire les risques de tentative d’évasion, SOS Médecins est habilité depuis mars à intervenir au sein même du lieu de captivité ».
Julie Ménard livre ainsi un reportage au sein de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Beauvais, où « les détenus n’ont rien à envier au système médical classique ».
La Dre Vanessa Thery, cadre de santé, indique qu’« ici, le temps d’attente pour voir un médecin est moins long qu’à l’extérieur. On peut voir un dentiste en 3 semaines contre 6 mois d’attente pour obtenir un rendez-vous dans le secteur ».
Julie Ménard précise que « le protocole imposé au personnel soignant et pénitentiaire est beaucoup plus strict. Lors des journées les plus chargées, jusqu’à 170 passages sont enregistrés. De quoi créer des mouvements sensibles parmi les 700 hommes et femmes incarcérés dans l’établissement ».
La journaliste relève notamment que « l’équipe détachée par l’hôpital Simone-Veil de Beauvais travaille aux côtés des psychologues du centre hospitalier Isarien de Clermont. Des associations de lutte contre les addictions ou de dépistage ainsi que des spécialistes en dentition, radiologie ou gynécologie interviennent aussi régulièrement. Les détenus sont reçus individuellement, dans le respect du secret médical ».
Julie Ménard indique que « pour les cas plus graves, les détenus doivent être extraits vers l’hôpital local avec tous les risques que cela comporte ».
Elle explique que « depuis le 11 mars, Beauvais expérimente un autre mode de prise en charge. L’administration pénitentiaire a signé une convention de partenariat avec l’antenne locale de l’association SOS Médecins. Le Samu peut donc décider de faire appel à un médecin libéral d’astreinte pour venir consulter le détenu à toute heure, en cellule, plutôt que de l’envoyer à l’hôpital ».
Julie Ménard note par ailleurs que la nuit, « aux urgences, les prisonniers sont installés dans des cellules prévues à cet effet, sans contact avec la population. Mais les surveillants doivent attendre auprès d’eux jusqu’à la fin de la prise en charge. En cas d’hospitalisation, il faut rester jusqu’à la relève policière. Ce qui peut prendre des heures, voire la nuit entière ».
« Pour ce qui est des cas psychiatriques — 90% des détenus souffrent d’addiction et les trois quarts ont un traitement médicamenteux —, l’administration pénitentiaire surveille surtout ceux qui menacent de mettre fin à leurs jours », continue la journaliste.
Elle note en outre que « les équipes doivent veiller à ne pas se faire manipuler. Certains détenus peuvent exagérer leurs symptômes, notamment les douleurs, dans le but de se voir prescrire des médicaments puissants. Ceux-ci pourraient ensuite être revendus et alimenter un trafic de stupéfiants au sein même de la prison ».
« Dans les maternités, le défi du repérage des nourrissons « à protéger » »
Date de publication : 7 avril 2025
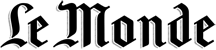
Mattea Battaglia explique dans Le Monde que « dans les hôpitaux, des équipes pluridisciplinaires sont chargées du repérage et de l’accompagnement des situations familiales complexes dont elles estiment parfois, avant même la naissance, qu’elles pourraient justifier une intervention de l’aide sociale à l’enfance ».
Sarah Tebeka, qui coordonne la filière de psychiatrie périnatale à l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP), à Colombes, précise ainsi que « la priorité durant la grossesse est de “border” au maximum les situations de vulnérabilité. Dès leur inscription à la maternité, les futures mamans sont questionnées sur leur parcours psychosocial, leurs antécédents psychiatriques, et, si un voyant clignote, on fait tout pour les intégrer à la filière de soins adéquats ».
La journaliste observe : « En première ligne, un «staff psychosocial» rassemble gynécologues, psychiatres et psychologues, mais aussi pédiatres, sages-femmes ou assistantes sociales, afin de croiser les regards et les expertises dans une «démarche collégiale», comme disent les soignants ».
« S’y ajoute souvent, dans les maternités dotées d’un service de néonatalogie, un «staff de parentalité», auquel peuvent être associés des représentants de la protection maternelle et infantile et d’autres, de l’aide sociale à l’enfance », relève Mattea Battaglia.
Elle note que « certaines situations laissent assez peu de place au doute quant à leur issue : un recours à l’ASE semble inévitable. Pour d’autres, nombreuses, il y a débat entre soignants, et le souhait de «se laisser du temps» ».
Tania Ikowsky, responsable de l’unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger à l’hôpital Robert-Debré (AP-HP, Paris), précise que« l’objectif est toujours d’aider les parents à être parents. On essaie de faire alliance avec eux en gardant en tête qu’ils peuvent, avec notre soutien, trouver les ressources nécessaires pour compenser les vulnérabilités, créer du lien avec l’enfant à naître, réussir à le sécuriser… Mais on doit aussi voir quand les facteurs de risque se cumulent et nécessitent une intervention de prévention ou de protection immédiate ».
Mattea Battaglia observe que « sur les centaines de grossesses ainsi accompagnées, chaque année, dans les grosses maternités franciliennes (3000 accouchements et plus), difficile de savoir combien, à la naissance, donnent lieu à une information ou à un signalement au procureur. Les médecins qui ont accepté de nous parler évoquent une « tendance » qui leur semble à la hausse, du fait d’une plus grande précarité sociale mais aussi de progrès dans le repérage anténatal ».
Le Pr Elie Azria, gynécologue-obstétricien, chef de la maternité du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, remarque qu’« aucune histoire ne ressemble à une autre. Il peut y avoir des divergences de vues et d’appréciation au sein des équipes. On peut alors rédiger les informations préoccupantes à plusieurs, sans taire ces divergences ».
« La santé mentale encore trop difficilement prise en charge »
Date de publication : 8 avril 2025

Jean Cittone observe dans Le Figaro que « la crise sanitaire a permis de lever le voile sur la santé mentale des Français. Une personne sur cinq est aujourd’hui concernée chaque année par un trouble psychiatrique et 3 millions de Français souffrent de troubles psychiques sévères. La prise en charge de ces maladies représente plus de 23 milliards d’euros de dépenses par an pour l’Assurance-maladie ».
Le journaliste ajoute que « les coûts directs et indirects sont estimés quant à eux à 163 milliards d’euros par an. Malgré une timide prise de conscience, la prise en charge de ces maladies reste une gageure. Pour mieux sensibiliser sur ce sujet, le gouvernement a décidé de faire de la santé mentale la grande cause nationale 2025 ».
Jean Cittone rappelle que « pour les personnes angoissées, déprimées ou souffrant d’un mal-être, l’Assurance-maladie a mis en place en 2022 le dispositif Mon soutien psy, en remboursant désormais 12 consultations par an chez un psychologue. Un investissement de plus de 118 millions d’euros, partagé avec les complémentaires santé, qui commence à porter ses fruits ».
Le journaliste indique que « près de 600.000 Français ont déjà bénéficié de Mon soutien psy depuis son lancement et 5500 psychologues avaient intégré le dispositif début 2025, alors qu’ils n’étaient qu’environ 2500 à la même période en 2024 ».
Jean Cittone relève cependant que « notamment échaudés par le plafond des montants qui leur sont remboursés, les psychologues ne se précipitent pas pour autant. La densité de praticiens partenaires n’atteint en effet que 8 pour 100.000 habitants, alors que nos voisins allemands ont quant à eux un ratio de 38 pour 100.000 habitants ».
« L’Assurance-maladie, elle, estime qu’entre 16.000 et 18.000 cliniciens pourraient être conventionnés. En France, les psychologues ne sont pour l’instant pas reconnus juridiquement comme des professionnels de santé et ne possèdent pas de lecteurs de carte Vitale », poursuit le journaliste.
Il relève en outre que « Mon soutien psy ne traite cependant que des troubles mentaux légers. En mars, la Fédération hospitalière de France (FHF) a publié un baromètre révélant que l’accès aux soins en santé mentale et en psychiatrie «reste très dégradé» en France, à la fois à cause de «carences structurelles» mais aussi de «préjugés durables», 52% des Français sondés pensant encore qu’on ne guérit jamais vraiment de ces problèmes ».
Jean Cittone observe que « selon la FHF, une personne sur deux souffrant de troubles psychiatriques rencontre des difficultés d’accès aux soins, dont 47% à cause des délais d’attente pour un rendez-vous. La situation des jeunes est particulièrement préoccupante en 2024, avec un recours aux soins à l’hôpital pour les pathologies psychiatriques chez les 5-19 ans nettement supérieur à ce qui était attendu ».
Le journaliste indique par ailleurs que « face à la minimisation et à la stigmatisation des troubles psychiques, le gouvernement prévoit (…) de former 150.000 personnes aux premiers secours en santé mentale (PSSM) en 2025 pour mieux repérer d’éventuels troubles psychiques, que ce soit dans l’environnement personnel comme professionnel ».
« La Haute Autorité de santé (HAS) a, elle, adopté en février son programme pluriannuel pour la période 2025-2030, destiné à «intensifier son engagement afin d’améliorer le parcours de santé des personnes, dès l’émergence de troubles de la santé mentale, et de mieux prendre en charge les troubles les plus sévères» », note Jean Cittone.
« Dérives sectaires : les médecines alternatives au coeur des préoccupations de la Miviludes »
Date de publication : 8 avril 2025

La Croix annonce en effet que « la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a reçu 4571 saisines en 2024. (…) La santé et le bien-être arrivent en tête (37%) des signalements reçus entre 2022 et 2024, devant les cultes et spiritualités (35%) ».
Le journal remarque ainsi que « la santé reste particulièrement touchée par les risques de dérives sectaires, et les pratiques de soins non conventionnelles, y compris dans des établissements de santé, sont une source de «préoccupation», souligne la Miviludes ».
Le quotidien indique que « son précédent bilan, dévoilé en 2022, pointait déjà la santé comme «sujet de préoccupation majeur». Alors que les malades du cancer restent les plus touchés par les dérives sectaires en santé, la Miviludes s’inquiète désormais du développement de pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) au sein même d’établissements de santé ».
La Croix observe que « souvent considérées comme «douces», «complémentaires» voire «alternatives et finalement bénéfiques pour la santé», la grande majorité de ces pratiques «n’a pas été approuvée scientifiquement», souligne-t-elle ».
Le journal précise qu’« un grand nombre de signalements reçus par l’organisme, rattaché au ministère de l’Intérieur, dénoncent ainsi «la banalisation de ces pratiques au sein des établissements de santé », sans être nécessairement accompagnées de «mises en garde ou d’encadrement médical» ».
Le quotidien souligne que « les soins de support, notamment en cancérologie, «connaissent, à leur tour, des dérives à caractère sectaire» ».
La Croix observe qu’« en 2024, la Miviludes a adressé 45 signalements au parquet – contre 20 en 2021 -, fréquemment «sur des “conseils” ou “pseudo-soins” donnés à des “patients “ (…) par des pseudo-thérapeutes n’ayant pas de diplôme reconnu par l’État». D’autres infractions concernent «les délits d’exercice illégal de la pharmacie, de la diététique, d’usurpation du titre de docteur en médecine» ».
Le journal précise que « dans la plupart des cas, les «pseudo-thérapeutes» prônent un régime alimentaire draconien, incitent à la consommation de stupéfiants, de soins à base de pierres (lithothérapie), ou d’examen de tumeur «par appareil “russe à résonance magnétique” qui contredit le diagnostic de cancer», énumère la Miviludes. (…) Dans le traitement du cancer, l’organisme alerte sur la dangerosité de l’urinothérapie, méthode «qui consiste à boire son urine» et qui a été «fatale» pour certaines victimes ».
La Croix indique que « pour mieux sécuriser les soins de support proposés aux malades et éviter de possibles dérives, la Miviludes, le ministère de l’intérieur et la Ligue contre le cancer vont signer mardi une convention de partenariat ».
« Dépression du post-partum, faut-il blâmer la pilule ? »
Date de publication : 9 avril 2025

Bénédicte Lutaud remarque dans Le Figaro que « les femmes seraient deux fois plus touchées par la dépression que les hommes. Chaque année, entre 8 et 16% de celles âgées de 18 à 50 ans sont atteintes de cette maladie psychique, et ce chiffre grimpe à près de 20% pour les femmes enceintes ou dans la période post-partum ».
La journaliste évoque le livre des psychiatres Lucie Joly et Hugo Bottemanne, La dépression au féminin, et relève : « Parmi les explications, les facteurs hormonaux sont désormais établis. En effet, le risque de dépression s’accroît lors de différentes étapes de «grands remaniements hormonaux», explique la Dr Lucie Joly ».
Bénédicte Lutaud poursuit : « Qu’en est-il des hormones de synthèse ? La réponse n’a rien d’évident. Elle intéresse en tout cas les chercheurs, et notamment l’équipe danoise du département de recherche de neurologie et neurobiologie de l’hôpital universitaire de Copenhague ».
La journaliste fait savoir que « dans une étude parue fin mars dans la revue Jama Network, Søren Vinther Larsen et ses collègues concluent que débuter une contraception hormonale après l’accouchement serait associé à un risque accru de développer une dépression du post-partum (DPP) ».
Bénédicte Lutaud explique que « les chercheurs danois se sont basés sur les données du registre national de santé danois, ce qui leur a permis d’étudier une cohorte de 610.038 femmes devenues mères pour la première fois ».
« Le risque de dépression du post-partum est 1,49 fois plus élevé après l’initiation d’une contraception hormonale. Un risque accru qui s’observe avec tout type de contraceptif hormonal : pilules combinées, stérilets, implants, patch ou anneau vaginal. Seule exception, les pilules progestatives (ou dites microdosées) sont associées à un risque réduit en début de post-partum, puis accru en post-partum plus tardif », note la journaliste.
Elle précise que « les chercheurs font l’hypothèse que ces pilules, souvent prescrites aux mères allaitantes pour limiter les potentiels effets néfastes d’autres contraceptifs hormonaux, sont parfois prises plus tardivement après la prescription ».
« Il s’agit toutefois d’une étude observationnelle, reconnaissent les chercheurs, qui invitent donc à la prudence », poursuit Bénédicte Lutaud, qui rappelle que « la recherche, sur cette thématique, reste contradictoire ».
Søren Vinther Larsen remarque ainsi : « Il se peut que seulement un petit sous-groupe de femmes développe une dépression due à l’usage d’un contraceptif hormonal, et les effets pourraient ne pas être les mêmes chez toutes les femmes ».
Bénédicte Lutaud indique par ailleurs que « la méthodologie de l’étude suscite également quelques réserves, puisqu’elle comporte de nombreux biais ».
La Dr Joly réagit : « Des femmes risquent d’avoir peur de prendre leur contraceptif. Or, après l’accouchement, il y a un véritable tsunami hormonal. Une femme sur cinq est touchée par la dépression du post-partum, il est difficile de faire la différence entre des remaniements hormonaux, physiologiques et les effets de la contraception ».
Søren Vinther Larsen indique pour sa part : « Nous avons trouvé une petite augmentation de risque absolu, ce qui souligne que les femmes ne devraient pas, d’une manière générale, restreindre leur conception hormonale en raison d’inquiétudes sur la dépression ».
« Un médicament offre une première piste prometteuse contre l’addiction à la cocaïne »
Date de publication : 9 avril 2025

Delphine Chayet remarque dans Le Figaro qu’« alors que la consommation de cocaïne atteint des niveaux records en France, il n’existe aucun médicament approuvé pour soigner cette addiction. (…) La cocaïne serait à l’origine de 10.000 hospitalisations par an, et de complications médicales dont la gravité et la fréquence augmentent ».
La journaliste fait savoir que « des chercheurs du laboratoire Novartis présentent une piste thérapeutique jugée « prometteuse », qu’ils ont testée pour la première fois chez l’être humain », selon un travail publié dans Science Translational Medicine.
Elle explique ainsi que « les scientifiques ont cherché à modérer l’activité d’un neurotransmetteur excitateur du cerveau, le glutamate, impliqué dans le traitement de la récompense et de la dépendance à la cocaïne. (…) Ils ont utilisé une molécule déjà connue, le mavoglurant, capable de bloquer un récepteur au glutamate, appelé mGluR5 ».
Delphine Chayet précise que « 70 adultes présentant un trouble de la consommation de cocaïne en poudre, prise par sniff nasal, ont été recrutés en Suisse, en Espagne et en Argentine pour participer à cet essai clinique de phase 2. Une partie d’entre eux s’est vue proposer le mavoglurant oral, à raison de deux fois par jour pendant quatorze semaines. Les autres ont reçu un placebo ».
La journaliste relève qu’« au bout de 98 jours, l’effet du traitement est significatif (…) : il réduit la proportion de jours comportant une prise de cocaïne. Une recherche complémentaire dans les urines et les cheveux confirme que le groupe traité par mavoglurant présente moins de résidus de cocaïne, mais aussi d’alcool, que les participants sous placebo ».
Delphine Chayet note en outre que « dans les trois dernières semaines de l’étude, 28% des patients du groupe traité étaient abstinents à la cocaïne, contre 8% dans le groupe placebo. (…) Des maux de tête, des vertiges et des nausées ont été fréquemment observés ».
Florence Noble, directrice de recherche au CNRS, déclare que « ces résultats sont très encourageants mais ils devront être confirmés par d’autres études. Le nombre de participants, essentiellement des hommes de type caucasien, est très réduit. Par ailleurs, on ne sait pas si le traitement continue à produire des effets au-delà des 3 mois de l’étude ».
La journaliste conclut que « le mavoglurant devrait maintenant être testé dans le cadre d’un essai clinique de phase 3 par une société de biotechnologie ».
« Pourquoi les Français sont (toujours) trop accros aux benzodiazépines »
Date de publication : 10 avril 2025


Nicolas Berrod indique dans Le Parisien que « l’agence du médicament lance, ce jeudi, une nouvelle campagne de sensibilisation pour inciter à moins prescrire et avaler ces médicaments. La France est le deuxième consommateur de benzodiazépines en Europe, avec 9 millions de Français traités l’an dernier », souligne le journaliste.
Il précise que le « nombre de consommateurs en France a baissé dans les années 2000, mais de seulement 5% depuis dix ans ». L’ANSM souligne que « cette diminution reste modeste et le nombre de consommateurs reste trop élevé », sa directrice générale, Catherine Paugam-Burtz, ajoutant que « cela augmente chez les jeunes ».
Le journaliste rappelle qu’« aussi efficaces soient-ils pour calmer les angoisses, les troubles psychiques ou aider à mieux dormir, ces médicaments présentent aussi de nombreux risques : somnolence, convulsions, accidents de voiture par manque de concentration, etc. Les personnes âgées risquent davantage de faire des chutes, avec – parfois – de lourdes conséquences sur leurs corps fragiles ».
Nicolas Berrod ajoute que « certaines benzodiazépines (…) pourraient aussi générer une certaine dépendance chez les patients, surtout à forte dose ou sur une longue durée. (…) Plusieurs études suggèrent par ailleurs un risque accru de démence ».
Le journaliste relève que « la grande majorité des prescripteurs sont des médecins généralistes. Auraient-ils la main trop lourde ? ».
Le Dr Sébastien Adnot, praticien à Carpentras, secrétaire général adjoint de MG France, répond que « les médecins généralistes prescrivent beaucoup en France, mais pas comme des bonbons non plus. Et c’est avant tout car il y a hausse de l’anxiété dans la société depuis le Covid, et car la psychiatrie française est à terre ».
Nicolas Berrod remarque que « pour toucher les jeunes, la nouvelle campagne de pub passera aussi par les réseaux sociaux, avec le soutien de cinq influenceurs. En parallèle, davantage de boîtes plus petites vont être mises sur le marché par les laboratoires ».
Nathalie Raulin explique également dans Libération qu’« à partir de ce jeudi 10 avril et pour 5 semaines, l’ANSM lance une vaste campagne d’information pour sensibiliser l’opinion et les médecins au bon usage des benzodiazépines ».
La journaliste retient un « un angle d’attaque précis : la nécessité de respecter les recommandations de durée de traitement ».
Catherine Paugam-Burtz déclare que « moins de 3 Français sur 5 savent que ces médicaments doivent être pris sur des durées courtes, soit moins de 3 mois dans le traitement de l’anxiété et moins de 3 semaines dans le traitement de l’insomnie. Il nous est apparu que nous avions là une piste d’action pour améliorer le bon usage de cette classe de molécules ».
Nathalie Raulin précise que « si l’ANSM ambitionne «d’acculturer toutes les tranches d’âge» au bon usage des benzodiazépines, elle vise plus particulièrement deux catégories de la population. D’abord les 18-25 ans, dont la consommation, quoique globalement très faible, a augmenté chez les jeunes filles. (…) Mais c’est surtout les plus de 65 ans que veut toucher l’ANSM. (…) Ils sont les premiers consommateurs de ces molécules, et les plus enclins à prolonger le traitement au-delà des recommandations sanitaires ».
La journaliste ajoute que « les généralistes, à l’origine de 75% des prescriptions de benzodiazépine, ne sont pas oubliés ». Philippe Vella, directeur de la direction médicale de l’ANSM, remarque que « 40% des patients traités (…) le sont sur des durées trop longues, non conformes aux recommandations. Or cet usage prolongé favorise les effets indésirables liés à la prise de ces médicaments ».
Nathalie Raulin indique ainsi que « les laboratoires producteurs des benzodiazépines hypnotiques (contre les insomnies) ont été invités à les fournir en petit conditionnement (5 à 7 comprimés). De quoi mieux calibrer les prescriptions et limiter la tentation des patients de finir les boîtes à leur guise ».
« Une étude pour mieux comprendre comment la dépression se conjugue au masculin »
Date de publication : 14 avril 2025

Sophie Massieu remarque en effet dans Le Figaro qu’« on comptabilise deux fois plus de diagnostics de dépression chez les femmes, mais trois fois plus de suicides chez les hommes »
La journaliste fait savoir que « lancée avec le soutien des fondations Pierre-Deniker et Sisley-d’Ornano, l’étude Gendep ambitionne de démêler les causes d’une telle situation. Un moindre recours des hommes aux soins psychiatriques ? De possibles symptômes mal identifiés, parce que différents de ceux des femmes et mal connus ? ».
Margaux Hazan, interne en psychiatrie et chercheuse en santé publique, responsable de l’étude, observe : « A l’hôpital ou au sein des services d’urgences, nous rencontrons des hommes en dépression, souvent sévère. Cela contraste avec les soins de psychiatrie en ville, où Doctolib comptabilise deux tiers de patientes parmi les prises de rendez-vous chez un psychiatre ».
Sophie Massieu explique que « des hommes et des femmes déprimés vont donc être interrogés en nombre. Ils appartiennent à la cohorte ComPaRe (Communauté de patients pour la recherche) de l’AP-HP. La plateforme compte déjà plus de 5000 inscrits sur son volet «dépression», mais elle aimerait en rassembler davantage, et rééquilibrer le nombre d’hommes, qui représentent pour l’heure seulement 20% des participants ».
La journaliste note que le « but principal (de l’étude) vise à déterminer l’existence, ou non, de symptômes spécifiques de la dépression chez les hommes. (…) 90 symptômes ont été listés. Certaines émotions comme la tristesse, mais d’autres aussi, comme l’irritabilité. Des éléments davantage d’ordre comportemental, à l’instar du recours à des substances psychoactives (alcool, tabac…), ou encore des difficultés dans les relations aux autres, et des symptômes sexuels ».
Astrid Chevance, psychiatre au Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (Cress), précise : « En interrogeant les patients sur ce grand nombre de manifestations possibles de la dépression, l’idée consiste à déterminer si certaines sont plus saillantes chez les hommes, mais aussi comment elles s’agencent entre elles et s’articulent avec des variables comme l’âge, le statut socio-économique… ».
Sophie Massieu ajoute qu’« une fois la spécificité des symptômes mieux précisée, les chercheuses indiquent que les résultats de l’étude pourront être rapidement utilisés de façon opérationnelle en pratique clinique. Mais aussi en recherche, puisque des échelles plus sensibles à la dépression masculine pourront voir le jour et affiner les travaux sur la prévalence, autrement dit le nombre de dépressions ».
« Suicides à l’hôpital : une vingtaine de soignants attaquent en justice les ministres Catherine Vautrin et Elisabeth Borne »
Date de publication : 14 avril 2025
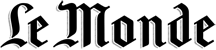
Rémi Dupré et Stéphane Mandard annoncent dans Le Monde qu’« une plainte a été déposée devant la Cour de justice de la République notamment pour «harcèlement moral» et «homicides involontaires». Elle vise les ministres de la Santé et de l’Education, ainsi que le ministre délégué à la Santé et à l’accès aux soins, Yannick Neuder, jugés responsables des conditions de travail dégradées des établissements publics ».
Les journalistes reviennent sur plusieurs suicides de soignants en 2023 et 2024, et expliquent que « pour tenter de mettre fin à cette «épidémie de suicides à l’hôpital public», plusieurs veuves et veufs de médecins ou de soignants ont décidé de «briser l’omerta» en saisissant la justice. (…) Une plainte a été déposée (…) devant la Cour de justice de la République (CJR) pour «harcèlement moral, homicides involontaires et violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner et mise en danger de la personne» ».
Rémi Dupré et Stéphane Mandard évoquent ainsi « une première, pour dénoncer une dérive de l’hôpital dont les plaignants estiment l’Etat responsable. (…) La plainte regroupe 19 requérants, qui ne se connaissent pas. Dix-neuf histoires de souffrances qui concernent tous les corps médicaux (infirmière, chef de service, directeur), toutes les spécialités (pédiatrie, néphrologie, cardiologie, psychiatrie, gynécologie…) et toutes les régions de France. Dix-neuf récits qui racontent un hôpital au bord de l’implosion, laminé par la crise engendrée par le Covid-19 ».
Un directeur d’un établissement du Nord déclare ainsi : « Moi aussi, j’aurais pu passer à l’acte. (…) Je me suis retrouvé à la tête d’un hôpital en train de s’effondrer comme un pilote d’avion à qui on demande de sauter sans parachute ».
Les journalistes indiquent que « dans sa plainte, Me Christelle Mazza s’appuie sur la jurisprudence tirée d’un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en janvier dans l’affaire France Télécom sur la responsabilité pénale des dirigeants de l’entreprise et la notion de «harcèlement moral institutionnel» ».
Rémi Dupré et Stéphane Mandard continuent : « La fonction publique hospitalière tient-elle des statistiques sur les cas de suicides de ses agents et praticiens ? Le Centre national de gestion n’a pas répondu à nos sollicitations. De son côté, l’Observatoire national du suicide déplore «ne pas avoir, aujourd’hui, les moyens de connaître les taux de décès par suicide par profession» ».
Les journalistes citent notamment un membre de l’Epsan (Etablissement public de santé d’Alsace Nord), un centre hospitalier spécialisé en santé mentale dans le Bas-Rhin, qui évoque « une banalisation du suicide : on montre la même indifférence aux suicides des agents que des patients alors que par notre métier, la psychiatrie, on devrait être plus vigilant à la souffrance au travail ».
Rémi Dupré et Stéphane Mandard relèvent que « dans un rapport publié en janvier 2025, la chambre régionale des comptes Grand-Est fait état de 7 décès par suicide de patients en 2021 et de 6 décès par suicide en 2022, à l’Epsan, sans mentionner ceux des agents, tout en évoquant des «tensions fortes sur le personnel médical et non médical» ».
Les journalistes observent que « la directrice de l’Epsan, Yasmine Sammour, indique qu’à la suite du suicide de monsieur M. «un travail transversal considérable» a été mené afin, notamment, de «reconstituer une équipe de santé au travail, avec une équipe désormais complète» et de «réaliser une nouvelle démarche de diagnostic des risques psychosociaux». Concernant les trois suicides survenus après celui de monsieur M., la directrice explique ne pas disposer «d’éléments pouvant indiquer un lien avec l’établissement» ».
« À l’hôpital, les pédopsychiatres face aux ravages de l’addiction aux écrans »
Date de publication : 18 avril 2025

Stéphane Kovacs livre dans Le Figaro un reportage dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert-Debré, à Paris, relevant : « Interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans ? Des portables à l’école ? Clara Chappaz, ministre chargée du Numérique, s’est rendue (dans l’établissement) pour évaluer ces différentes pistes ».
Le journaliste observe ainsi : « Idées suicidaires, conduites autoagressives, cyberharcèlement : ici, sont soignés des jeunes « addicts » aux écrans, aux substances, ou parfois aux deux. Faut-il interdire totalement les écrans avant 3 ans ? À l’école ? ».
Stéphane Kovacs note que « les experts de l’hôpital parisien se montrent plus mesurés : «Plutôt éducation qu’interdiction», plaident-ils ».
Le Dr Vincent Trebossen, pédopsychiatre, souligne : « L’usage des réseaux sociaux, c’est la question que les parents nous posent systématiquement, pointant “la responsabilité de TikTok” dans le mal-être de leur enfant. On leur donne des conseils, mais aujourd’hui, on n’a pas de connaissances assez précises sur l’impact des réseaux sociaux sur le développement cognitif de l’enfant ».
« Un ado déprimé va passer plus de temps sur les réseaux, et ceux-ci peuvent mener à la dépression… C’est pour cela que nous voulons, à terme, infiltrer ces réseaux sociaux. Il existe d’ailleurs déjà des initiatives de jeunes qui y montent des groupes de soutien pour s’entraider entre pairs. Guider les influenceurs vers les bonnes pratiques aurait aussi un effet vertueux », continue le médecin.
Stéphane Kovacs explique que « la ministre déléguée Clara Chappaz, qui a fait de «la protection des mineurs en ligne une priorité», a souhaité aller à la rencontre «des personnes qui sont en première ligne : soignants, enquêteurs, chercheurs», pour l’aider à «avancer dans (sa) réflexion politique» ».
Le Dr Trebossen souligne : « Il faut plutôt être dans la guidance parentale. La clé, c’est aussi l’échange que l’on va avoir avec l’enfant ».
Le journaliste note qu’« un «conseil très simple et efficace» serait de demander à «toute la famille» de «poser son portable le soir dans un panier». Car il s’agit de ne pas donner le mauvais exemple, avertit la Dr Sylvie Derobert, spécialisée en addictologie périnatale, qui voit «des jeunes mamans allaiter, un œil sur leur smartphone» ».
Stéphane Kovacs continue : « Interdire les réseaux sociaux avant 15 ans ? Instaurer une «pause numérique» dans tous les lycées dès la rentrée prochaine, comme le demande la ministre de l’Éducation, Élisabeth Borne ? Là non plus, les experts ne valident pas ».
L’un d’eux remarque que « c’est plutôt un échec de bannir les matières addictives ! Un jeune trouve toujours un moyen pour contourner l’interdiction. En hospitalisation, les ados ont souvent deux téléphones : celui qu’ils confient à l’entrée, et celui qu’ils gardent en cachette… Pour moi, c’est un non-sens de leur demander de déposer leur téléphone dans un casier à l’école ».
Stéphane Kovacs continue : « Comment atteindre ces parents, ces enseignants, tant demandeurs de conseils ? Créé après le Covid et ses confinements, le site CléPsy propose aujourd’hui gratuitement quelque 200 fiches en ligne, écrites par des experts ».
Nesrine Bouchlaghem, psychologue clinicienne, indique que « l’année dernière, on a eu un million de nouveaux visiteurs. Environ 90.000 utilisateurs se connectent chaque mois. Des Français mais aussi des francophones du monde entier ! ».
« Les bienfaits insoupçonnés de la tendresse sur la santé »
Date de publication : 18 avril 2025

Dans sa chronique pour Le Point, Stéphane Demorand relève que « les gestes d’affection, qu’il s’agisse d’un câlin chaleureux ou d’un baiser passionné, ont longtemps été perçus comme de simples marques d’amour. Aujourd’hui, la recherche scientifique établit que ces interactions physiques possèdent de nombreuses et surprenantes vertus pour notre santé ».
Le masseur-kinésithérapeute et journaliste explique ainsi que « de très nombreuses études mettent en lumière l’effet bénéfique des câlins sur le stress. Lorsque l’on prend dans ses bras un être cher, le corps libère de l’ocytocine, «l’hormone de l’amour», qui aide à diminuer les niveaux de cortisol (hormone du stress) ».
« Selon une étude publiée dans Plos One, recevoir régulièrement des câlins peut contribuer à une meilleure gestion du stress quotidien. Une autre recherche nous révèle que les câlins semblent également favoriser la santé cardiovasculaire – en particulier chez les femmes – en abaissant la tension artérielle et en modulant le rythme cardiaque », poursuit-il.
Stéphane Demorand précise qu’« embrasser augmente la fréquence cardiaque et conduit à une dilatation des vaisseaux, provoquant ainsi une augmentation du flux sanguin et une baisse de la tension artérielle. Sur le plan cardiovasculaire, les embrassades fréquentes peuvent même améliorer le taux de cholestérol selon cette étude ».
Il ajoute qu’un autre article « souligne que les câlins renforcent la réponse immunitaire et pourraient même limiter la gravité des infections. Une autre étude suggère que l’échange de salive est susceptible de renforcer l’immunité en nous exposant à d’autres germes et bactéries présents dans le microbiote salivaire de notre partenaire ».
Stéphane Demorand relève que « l’inflammation peut aussi être modulée par les câlins selon cette analyse, qui révèle que l’inflammation dont souffraient les candidats, mesurée à l’aide d’échantillons de salive, était inversement proportionnelle au nombre de câlins qu’ils avaient reçu au cours des 14 derniers jours ».
Il souligne qu’« à l’instar des câlins, les bisous stimulent la libération d’un véritable cocktail hormonal, incluant la dopamine, la sérotonine et l’ocytocine. Ce mélange contribue à une sensation de plaisir et de bien-être, agissant comme un antidépresseur naturel ».
« Les hormones sécrétées lors des moments de tendresse sont susceptibles de nous rendre euphoriques, d’encourager les sentiments affectueux et d’attachement, diminuent le niveau de cortisol », continue Stéphane Demorand.
« Errance médicale, souffrance psychologique : le fléau sous-estimé des erreurs de diagnostic »
Date de publication : 22 avril 2025

Delphine Chayet observe dans Le Figaro que « dans un rapport publié en décembre 2024, la Haute Autorité de santé (HAS) souligne que les erreurs de diagnostic – un diagnostic retardé, erroné ou non communiqué au patient – sont plus courantes que les erreurs médicamenteuses ».
« Elles affecteraient jusqu’à 10% des interactions cliniques entre patients et médecins, et seraient à l’origine, selon les études, de 7% à 36% des événements indésirables », note la journaliste.
Candice Legris, adjointe à la chef du service chargé de l’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins à la HAS, remarque ainsi qu’« elles sont à la fois très fréquentes et complètement invisibilisées. Elles ont reçu moins d’attention que les autres erreurs médicales, sans doute parce qu’elles sont plus difficiles à identifier. Nous avons donc décidé d’alerter les professionnels de santé et les patients sur ce sujet ».
Delphine Chayet relève que « la HAS recommande l’élaboration d’un plan d’action national et une mobilisation de la recherche ». La journaliste explique que « les faux diagnostics peuvent survenir dans tous les services hospitaliers, les consultations de médecine et de radiologie, et même les laboratoires d’analyses médicales ».
Le Dr Jean-Marie Jacques, praticien hospitalier, souligne ainsi que « les médecins urgentistes sont particulièrement exposés du fait de leur charge de travail très lourde et de la pression liée à la gestion des flux. En plus, ils prennent en charge des patients inconnus, à toute heure, ils sont constamment interrompus et doivent souvent négocier les examens complémentaires ».
Delphine Chayet relève que « selon une étude réalisée en 2022 aux États-Unis, 1 patient accueilli aux urgences sur 18 reçoit un mauvais diagnostic, qui se traduit par un effet indésirable pour 1 personne sur 50 et un handicap sévère ou décès pour 1 patient sur 350. Cinq pathologies (AVC, infarctus du myocarde, anévrisme de l’aorte, compression de la moelle épinière et embolie veineuse) représentent près de 40% des erreurs de diagnostic graves dans ces services. L’AVC, la pathologie la plus grave, n’est pas décelé dans 17% des cas – en particulier quand il se présente sous forme de vertiges ou d’étourdissements ».
Le Dr Yamaldine Alouache, médecin-conseil auprès de la mutuelle MACSF, précise pour sa part que « ces erreurs concernent plus souvent des maladies fréquentes, auxquelles le médecin n’a pas pensé, que des pathologies rares. Mais il y a souvent une présentation atypique ou des symptômes trop précoces ».
Delphine Chayet ajoute que « la littérature scientifique a montré que la majorité des erreurs de diagnostic sont liées à des biais cognitifs. Dans un article publié en 2020, Jean-Marie Jacques en a dressé une liste non exhaustive : centrer son attention sur les données initiales sans tenir compte des éléments ultérieurs (biais d’ancrage), être influencé par un avis extérieur, comme celui d’une infirmière qui met en avant un symptôme, par exemple (biais de cadrage), arrêter trop rapidement ses hypothèses (biais de satisfaction), chercher à confirmer ce qu’on croit (biais de confirmation), accepter sans réserve un diagnostic initial (biais de conclusion prématurée)… ».
« Des facteurs liés au malade, notamment son milieu social, sa maîtrise du français et son origine, peuvent influencer le médecin », continue la journaliste.
Elle note enfin que « si toutes les erreurs de diagnostic ne sont pas évitables, la Haute Autorité de santé identifie plusieurs pistes d’amélioration. La formation des médecins aux biais cognitifs en fait partie ».
« Dans certains services, le travail en binôme – par exemple, la double lecture des radios – a permis de réduire le risque d’erreurs. La HAS compte aussi sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour attirer l’attention du médecin sur un diagnostic qu’il n’avait pas envisagé. Elle est déjà utilisée en imagerie, par exemple pour le diagnostic des tumeurs cérébrales, et en dermatologie », observe Delphine Chayet.
« Recherche sur la médecine psychédélique : « En France, on est hélas un peu à la traîne par rapport à nos voisins » »
Date de publication : 29 avril 2025

Margaux Gable note dans Libération qu’« après un arrêt brutal des recherches autour des substances psychédéliques (LSD, mescaline, champignons hallucinogènes…) en 1971 après leur classement dans la liste des stupéfiants de l’ONU, on assiste, depuis les années 2010, à une multiplication des études sur le sujet partout dans le monde ».
La journaliste livre un entretien avec Lucie Berkovitch, psychiatre et chercheuse en neurosciences à l’hôpital Saint-Anne, à Paris, selon qui « les idées reçues sur ces substances ont la vie dure en France. Malgré les freins, les études sur le sujet se multiplient depuis 15 ans ».
Cette dernière déclare notamment qu’« en psychiatrie, on se retrouve parfois face à des patients pour lesquels les traitements disponibles ne fonctionnent pas. Pour la dépression, on estime qu’environ un patient sur trois n’a pas une réponse satisfaisante aux antidépresseurs ».
Lucie Berkovitch précise qu’« outre la dépression résistante, les psychédéliques peuvent soulager l’anxiété dans les contextes de fin de vie, en soins palliatifs, où la détresse existentielle ressentie par les patients peut être très intense. Dans les cas d’addiction sévère, à l’alcool ou au tabac, ils peuvent également aider les personnes qui ont essayé de réduire ou d’arrêter leur consommation à plusieurs reprises et n’ont jamais réussi ».
Elle souligne que « l’une des différences majeures par rapport aux traitements habituels, c’est que les psychédéliques, associés à des séances de psychothérapie, sont efficaces dès la première séance. Et leurs effets semblent se maintenir dans le temps, de plusieurs semaines à plusieurs mois ».
Lucie Berkovitch indique que « les chiffres sont impressionnants : 60 à 80% des personnes arrêtent de fumer de façon durable ; en ce qui concerne l’alcool, elles divisent leur consommation par 5 ; pour la dépression, on observe, selon les études, entre 30 et 60% de rémission, c’est-à-dire de disparition des symptômes de la maladie. Mais cela ne fonctionne pas chez tout le monde, et il y a aussi un effet d’attente. […] Par ailleurs, ces chiffres ne sont pas uniquement le résultat de l’administration de substances, ils reflètent aussi l’efficacité de la thérapie qui est associée ».
Margaux Gable interroge : « Quel est l’état de la recherche sur le sujet en France ? ».
La psychiatre répond qu’« on est hélas un peu à la traîne par rapport à nos voisins européens et américains. Les premières études françaises chez des patients ont commencé en février 2024, avec une étude dirigée par la Pre Amandine Luquiens à Nîmes, évaluant l’efficacité de la psilocybine chez des personnes qui présentent à la fois un trouble lié à l’usage de l’alcool et une dépression. La deuxième à avoir démarré est celle dont je m’occupe à l’hôpital Sainte-Anne sur la dépression résistante ».
Lucie Berkovitch ajoute qu’« il y a évidemment un manque de moyens dans le secteur de la psychiatrie, qui est en grande souffrance. Mettre en place ces études très coûteuses et lourdes en termes d’organisation reste difficile mais plusieurs équipes, dont la mienne, ont réussi à obtenir des financements ces dernières années ».
La psychiatre observe en outre qu’« il y a tout un parcours administratif pour obtenir l’autorisation de mener ces études : les psychédéliques sont classés comme stupéfiants, il faut donc se justifier sur le plan éthique ».
« « Il nous fait tellement de bien » : à l’hôpital Foch, Toby le labrador est un soignant comme les autres »
Date de publication : 29 avril 2025

C’est ce que titre Le Parisien, qui explique que « la structure implantée à Suresnes (Hauts-de-Seine) vient de recruter Toby, un chien de 2 ans et demi, spécialement dressé, qui intervient dans tous les services. Son influence sur les patients et le personnel a été immédiate ».
Olivier Bureau observe ainsi que « dans les couloirs de Foch, il est celui qui ravive les sourires, il est le shoot de bonne humeur, le concentré de joie de vivre à poils courts. En quelques semaines, Toby est devenu la mascotte du centre hospitalier […]. L’hôpital vient de recruter ce splendide labrador noir, le 500e chien d’assistance formé par l’association Handi’Chiens, médaillé à ce titre le 26 mars à l’Assemblée nationale ».
Florian Auffret, responsable de l’organisme de formation, précise : « Nous proposons des chiens pour six métiers différents : pour les personnes à mobilité réduite, pour enfants polyhandicapés, autistes ou trisomiques, pour personnes épileptiques, chiens d’accompagnement social comme Toby, d’accompagnement judiciaire ou à la réussite scolaire ».
Olivier Bureau explique que « Toby est un membre du personnel à part entière. […] Quand il travaille, Toby revêt sa cape de «chien d’assistance». Avec leur accord et l’aval des médecins, le labrador intervient en gériatrie, en neurologie, souvent dans le cadre de la rééducation après un AVC, en soins palliatifs et en psychiatrie. À chaque fois, il a une ou un référent soignant par service et un planning précis ».
« Véritable boule de bienveillance et de douceur, avec son regard profond, sa bonhomie et ses gros coussinets, le labrador est un antidépresseur à quatre pattes. Pour les patients, il est une autre relation à l’hôpital et au traitement », continue le journaliste.
Aléna Sorret, responsable « expérience patient » de l’établissement, indique qu’« avec les personnes âgées, il joue sur les stimuli sensoriels et donne une motivation. En soins palliatifs, avec lui, le patient se focalise sur autre chose que la douleur. En rééducation après un AVC, en neurologie, Toby fournit là encore une motivation pour aller d’un point A à un point B : pour le caresser le patient dépasse son ras-le-bol ou sa peur et, presque inconsciemment, fait l’effort nécessaire. Sa volonté prend le dessus ».
Anne-Sophie Caplain, coordinatrice de santé du service de médecine interne, souligne qu’« il apporte du fun. Il n’a pas la blouse blanche et abolit la barrière entre patient et soignant. Rien qu’un échange de regard peut aider à verbaliser. Avec lui, c’est une relation de confiance totale, quelque chose d’absolu qui se noue avec le malade ».
Olivier Bureau précise que « Toby n’est pas un jouet, cependant, et son activité est extrêmement contrôlée. Après une heure de travail, cette éponge à sentiments a droit au double de détente. Foch lui a aménagé un véritable studio avec espace vert, jouets à gogo et baignoire privative pour être en permanence impeccable. Le suivi vétérinaire est drastique. Pas question de prendre du poids ou de se laisser aller. Toby est un athlète de la santé ».
Anne-Sophie Caplain ajoute qu’« il a un effet sur les patients et sur nous. Comme un effet miroir. Nous sommes dans un milieu souvent difficile et on peut saturer. Sa présence, ce sont des moments privilégiés, elle diminue la charge émotionnelle ».
« Les neurones ne fonctionnent pas du tout comme on l’imaginait »
Date de publication : 30 avril 2025

Alissa de Chassey remarque dans Le Figaro : « Que se passe-t-il exactement dans votre cerveau lorsque vous fredonnez votre nouvelle chanson préférée jusqu’à la connaître par cœur ? Le mécanisme neuronal de l’apprentissage reste encore assez mystérieux. Une équipe de chercheurs de l’université de Californie à San Diego vient néanmoins lever un coin du voile ».
La journaliste indique en effet que « leur découverte, publiée dans […] Science, «bouscule le modèle classique de la plasticité neuronale tel qu’on le concevait jusqu’ici», assure Laurent Groc, directeur de l’Institut interdisciplinaire de neurosciences de l’université de Bordeaux ».
« Les chercheurs ont en effet montré que les neurones et leurs connexions – les fameuses synapses – étaient bien plus «flexibles» dans leur fonctionnement qu’on ne l’imaginait », retient Alissa de Chassey.
Elle explique ainsi qu’ils « ont entraîné des souris à réaliser une tâche motrice : appuyer sur un levier après un signal sonore pour recevoir de l’eau. En deux semaines, les souris sont devenues plus rapides, plus précises : elles ont «appris» ».
William Wright, neuroscientifique à l’université de San Diego et coauteur, souligne : « Si nous ne connaissions pas encore parfaitement les règles qui régissent le fonctionnement des neurones et des synapses, c’est que, jusqu’à présent, nous n’avions pas les moyens d’observer ces mécanismes directement dans le cerveau ».
Alissa de Chassey note que « c’est l’excellente maîtrise d’une méthode d’imagerie de pointe, dite «biphotonique», qui a permis de faire une avancée considérable ».
Elle explique que « pendant l’apprentissage des souris, les scientifiques ont réussi à observer l’activité individuelle de neurones du cortex moteur (zone du cerveau qui contrôle les mouvements) à l’aide de deux faisceaux de lumière, permettant d’éclairer très précisément un point dans le cerveau, sans abîmer les tissus autour. Cela a permis de mesurer leur activité en temps réel avec une résolution inégalée, et de voir les synapses individuelles ».
Alissa de Chassey continue : « Ce que les chercheurs ont essayé de comprendre dans cette étude, c’est «l’algorithme» que le cerveau utilise pour sélectionner quelles synapses s’affaiblissent et lesquelles se consolident pendant l’apprentissage. Or il s’avère bien plus compliqué que ce que l’on pensait ».
« Ils ont découvert qu’un même neurone peut apprendre de plusieurs façons en même temps, selon la branche par laquelle arrive l’information. Par exemple, un neurone renforcera ses connexions aux neurones situées au bout de ses dendrites apicales (sur le haut de la cellule) quand plusieurs signaux lui arriveront en même temps. En revanche, sur d’autres branches, plus proches du centre du neurone (les dendrites basales), il ne renforcera une connexion que si un autre neurone est activé en même temps », indique la journaliste.
Elle retient ainsi : « Cette découverte montre que chaque partie du neurone applique sa propre «règle» pour traiter l’information, comme si chaque branche avait sa manière d’apprendre ».
William Wright observe qu’« un neurone seul suit plusieurs règles en même temps, ce qui engendre différents types de connexion, pour le même neurone ».
Alissa de Chassey remarque notamment que « ces travaux pourraient […] «avoir des répercussions majeures pour la santé», insiste Laurent Groc. En effet, pour les malades neuropsychiatriques, la plasticité des synapses est souvent un problème. […] Une meilleure compréhension de leur fonctionnement pourrait ainsi ouvrir la voie à des traitements plus ciblés et plus efficaces ».
« Retour à la revue de presse.